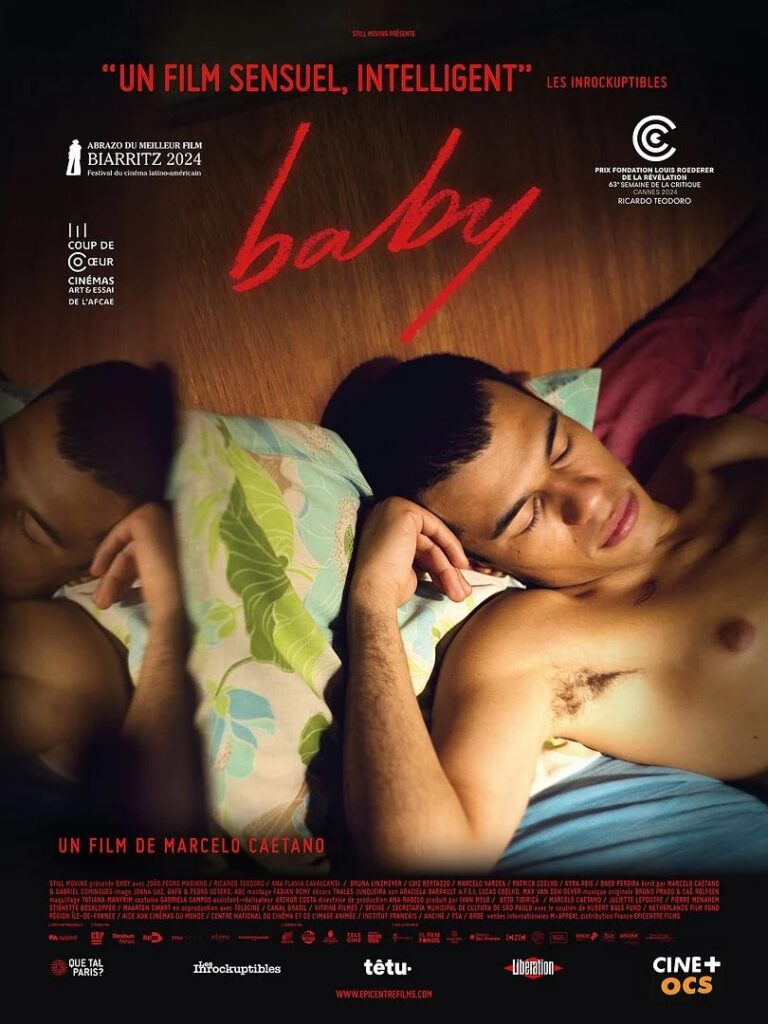La critique est à retrouver sur Culturopoing
La réussite d’un film ne tient pas à son équilibre, ce fameux adage qui voudrait mathématiser le cinéma en une addition cartésienne de bons points (la performance de ses acteurs, la qualité de son d’écriture, de sa bande-son, etc…), mais bien plus à son déséquilibre, à la mise en danger d’une linéarité qui étouffe. La grande réussite de 2023 et le merveilleux « Asteroid City » de Wes Anderson agace l’aveugle s’ennuyant devant sa mise en scène supposée robotisée, alors que sa force inouïe réside dans un jeu de dysbalance, ici verticale ciel-terre, amour-haine, deuil-renaissance. Le déséquilibre est bien le point de bascule d’un film vers l’émotion du danger, la pointe des pieds au bord du gouffre, une quête de précarité artistique et la capacité d’un metteur en scène à savoir reconsidérer sa filmographie par un souffle nouveau. Avec « Ferrari », Michael Mann nous sort un film anti-testamentaire, « déséquilibré », acceptant la fin de son monde, nous infligeant à chaque scène le souffle implacable de la mort, les corps sont dévitalisés, la disparition guette, l’absence prend le pas sur la présence, il y rôde une atmosphère funéraire, cet appel religieux à l’extinction avec un Enzo Ferrari courant indéniablement à sa perte, lui, et tous ceux qui l’entourent. Mann n’y joue pas le jeu du passé (l’intensité euphorisante de « Heat », la paranoïa du « Sixième sens » son véritable chef d’œuvre, la violence langoureuse de « Miami Vice » sont ici absentes) bien conscient d’un temps révolu qui ne l’appelle plus à s’exposer, mais bien à trouver dans son cinéma la piste d’un renouveau silencieux : là où « Ferrari » gagne la partie, c’est donc par sa capacité à tourner le dos à sa gloire passée, un film autobiographique qui voit un génie de l’avant devenir un fantôme du présent, Enzo, Michaël, deux hommes fusionnant un destin commun.
La grande majorité des cinéastes aurait joué la carte de la vitesse, sens commun de la marque italienne, avec un sur-jeu risible à la Ridley Scott (et le même Adam Driver en Maurizio Gucci), additionnant les courses à enjeu (récemment vu avec les mauvais « Le Mans 66 » et « Race of Glory ») avec on peut l’imaginer un montage nerveux. Mann prend la tangente en ne cessant de ralentir le tempo, il pose un Enzo Ferrari mortifère, figure de plomb intouchable, inémotif être dont l’omniprésence de la mort à ses côtés (les allers-retours au cimetière voir son fils décédé, le visage momifié de sa mère, les cernes tombantes de sa femme, le décès tragique de son coureur automobile) anesthésie à la fois un visage rigidifié et absent de l’excellent Adam Driver mais aussi le rythme d’une vie jonchée de temps-mort et d’attente (deux scènes l’évoquent avec brio, celle de l’église en parallèle d’un record sur piste, puis le suivi d’une course par téléphone, à distance). En ne se fixant que sur une courte période de la vie d’Enzo Ferrari (l’été 1957) Mann a tout juste : au lieu de courir après la chronologie, il prend le temps de bâtir la complexité de son personnage, et de manière très intelligente, dévier le cœur de son film sur la toxicité relationnelle avec sa femme Laura (interprétée par une Pénélope Cruz magistrale). Cet amour en forteresse impénétrable devient l’enjeu primordial du film, Laura dompte Enzo, dans l’ombre (quelle scène finale et ce face-à-face stratégique, les visages à peine dessinés par une lumière en berne), elle rôde et insuffle une énergie perverse, une acceptation de l’inacceptable dans l’intérêt seul de l’industriel. L’inacceptable, c’est cet enfant hors-mariage (Pietro, toujours aujourd’hui à la tête de l’empire Ferrari) l’élément tragique inaltérable qui pousse la virtuosité des courses en second-plan, le destin de ce gamin prenant désormais bien plus d’importance que la victoire aussi prestigieuse soit-elle, l’humain (le couple, l’enfant) prend définitivement la place de la technique (les courses), il n’est plus question de gloire, mais bien de survie (l’héritage au centre de cette bataille entre Enzo et Laura).
L’on pourrait parler d’une autre virtuosité, celle de Mann à filmer ses bolides brûlant l’asphalte, mais qui pouvait en douter ? L’on pourrait s’extasier du montage au cordeau, de cette mise en scène diabolique d’efficacité anxiogène, mais là encore, qui pouvait douter de Mann pour nous la procurer ? A rendre fou par ailleurs sa sortie unique sur plate-forme (Amazon Prime), et non en salle. Mais là encore, ce qui dénote avec son passé, c’est que la grandiloquence fait place à l’intime, l’impact des scènes intérieures (dans leur immense demeure à Modène, saint-sépulcre des Ferrari) éteint le rutilement extérieur : systématiquement, y compris après le fameux drame de Mille Miglia (10 civils tués après la sortie de route d’Alfonso de Portago), l’on voit Enzo courir s’y réfugier, cherchant désespérément une accalmie qui n’existera plus. La lenteur des plans intérieurs (y compris dans la maison de sa maitresse où vit son fils Pietro) contraste brutalement avec la vélocité extérieure, et Mann a fait le choix décisif d’y filmer la majorité de ses plans, métaphoriquement bien entendu, en pénétration de l’intime. On ne peut non plus balayer la filmographie de Michael Mann en supposant sa réinvention avec « Ferrari », la mort qui traverse toute sa filmographie (et notamment avec le destin tragique de Mohammed Ali dans le film éponyme) est bien entendu dominante ici, sa mise en scène signature également n’a pas été effacée, mais ce fameux déséquilibre synonyme de grand film se joue ici entre un extérieur mesuré (à peine deux scènes de course marquantes au compteur) et un intérieur en immensité (le jeu pervers entre Enzo et Laura), à l’inverse de sa filmographie passée qui a toujours préféré l’extérieur, la « théâtralité » d’action (avec les paysages de Miami, Los Angeles, la province de New-York des Mohicans) plutôt que le confinement.
Ferrari est une œuvre soufflée par la mort et l’absence, où le cœur de sa réussite naît de l’intime (la relation avec sa femme Laura, et son fils Pietro) et non de la pétulance d’une mise en scène économe et franchement bouleversante de maîtrise, une tragédie sans larmes, une inémotivité salvatrice.