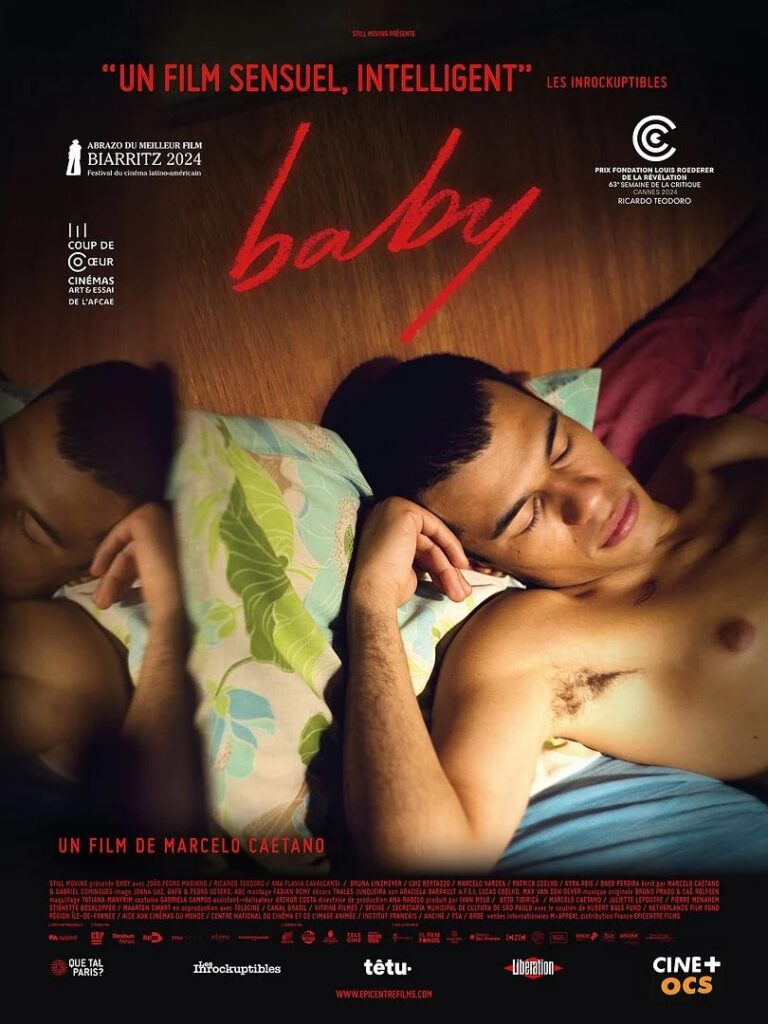L’année 2017 a peine achevé dans un torrent d’immondes promesses hypocrites, de résolutions Kalenji (et ces nouveaux collants de running que vous venez d’acheter), avec cette idée naïvement soutenue par un tas d’enculés en sur-poids qu’ils sortiront dès le 2 janvier courir sur un canal St Martin givré. On y croit les mecs. En attendant, nous on s’occupe de l’année cinéma passée, résolument dystopique et qui a chamboulée à nombreuses reprises notre rythme tachychardique de sédentaire crouté dans la salle obscure du quartier. Si l’on compare à une année 2016 marquée par son temps et ancrée dans sa génération, la 2017 en ressort bien plus fictionnelle, d’un angle résolument prédictif, se voulant prévisionnelle d’une époque que l’on ne connaît pas mais que l’on sait déjà perdu. On pense immédiatement à la Mise à mort du cerf sacré de Y. Lanthimos, superbe mise en scène d’une famille délitée par le mensonge et le non-dit, détruit à feu vif par le spectre mortifère d’un ado à la peau grasse dictant les repères perdus d’une société qui perd toute notion de bien et de mal. On rebondit sur Lynch et la beauté inclusive de la troisième saison de Twin Peaks, l’histoire de fantôme de Lowery (A Ghost Story)qui installe en son cœur le deuil par sa matérialisation physique, et Cocoqui lui le délie pour mieux appréhender la vie après la mort. Autre histoire de fantôme, celle ci cyborg et raté avec Gosht in the Shell qui n’aura malheureusement pas réussi à relancer la peur désormais oubliée car intégrée de l’intelligence artificielle robotique. On préfère le somptueux Blade Runner 2049, rare réussite de Denis Villeneuve, qui dans un décor contemplatif tarkovskien amène à réfléchir sur l’avenir d’un monde à la Dantec, notre monde qui vient s’effondrer inexorablement sur les mêmes questions de survie, d’amour, de sexe, de possession, d’héritage. Qu’importe l’époque, qu’importe celui qui se les pose.
On ne peut non plus occulter la fabuleuse Palme d’or The Square venue frapper la bourgeoisie de comptoir vinassée dans les burnes, et mettre un coup de bambou à jour l’ordre pré établi par la bien-pensance vomitive. Quel plaisir mesquin d’apprécier l’effondrement d’un parvenu profondément xénophobe, grimé par l’apparat d’un art contemporain d’une superficialité crasse. Sévèrement passée sous silence médiatique, la farandole sous acide des Safdie et Good Time est une belle claque d’une violence citadine aussi brutale que le marteau du psychopathe Joaquim Phœnix dans A Beautiful Days. On ferme les yeux car le story-telling pique les gencives pour mieux s’immerger dans le bruit des balles qui sifflent, les explosions fumantes et la chaire qui crame dans Dunkerque, expérience sensorielle unique mais probablement trop Futuroscope pour une réussite totale. L’on conclue avec la joie à l’amour, l’appel à l’espoir malgré la violence d’une vérité trop souvent oubliée, 120 BPM et sa musique électrifiante comme une balle calibrée d’Arnaud Rebottini. Comme cette année 2017, plein d’amour, d’espoir, même dans une situation perdue, une société qui s’éteint. L’ironie de l’humanité, crever et en rire.