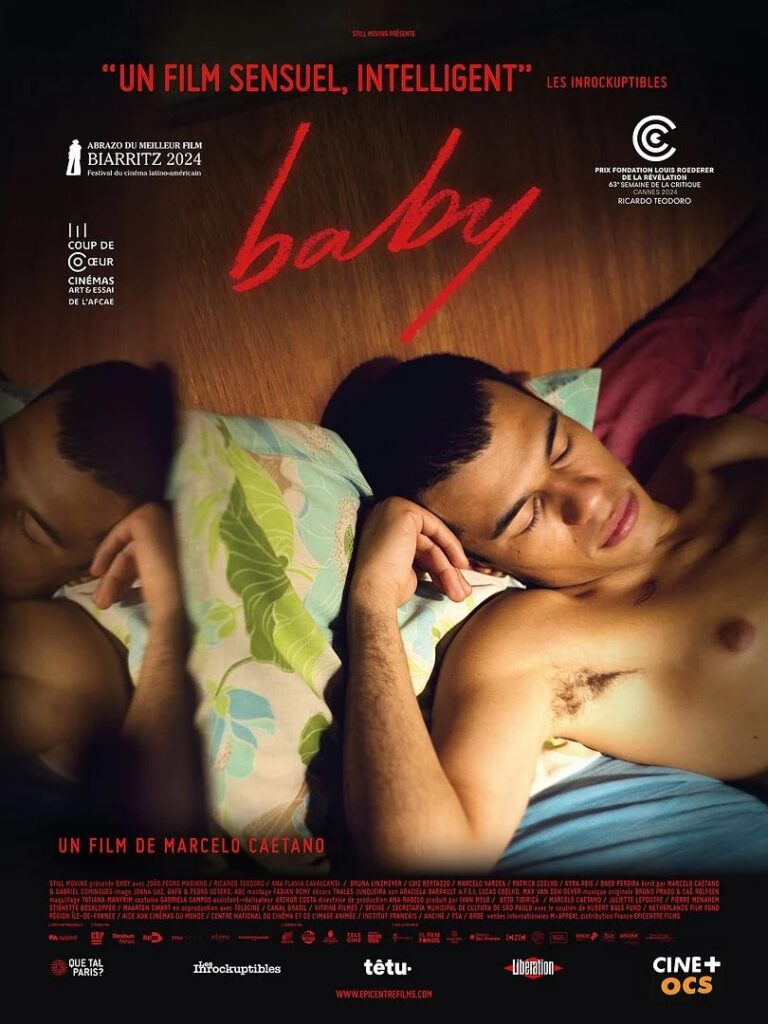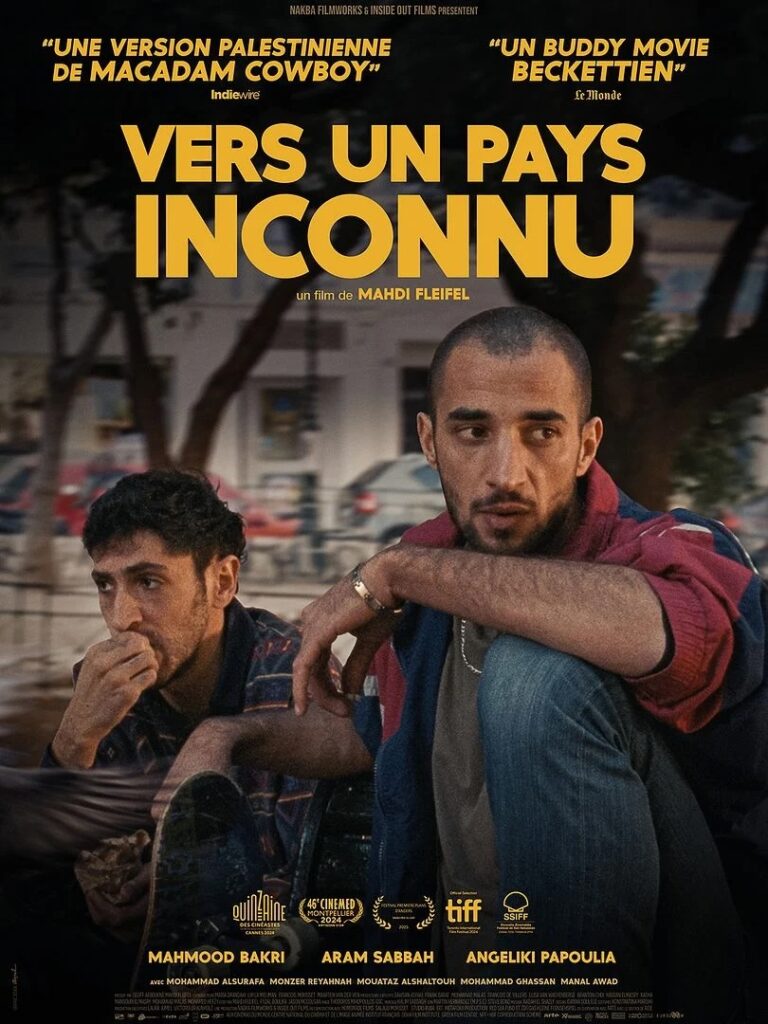La critique est à retrouver dans Culturopoing
Après son film-flou In Water investiguant la finitude des choses et la nostalgie en fantôme du
temps présent, Hong Sang-soo est de retour avec une nouvelle obsession, celle du langage et de l’apprentissage. Mais pas par n’importe quel vecteur, car c’est bien le cœur qui dictera la leçon, et non la chimie synaptique du cerveau. Inès, interprétée par Isabelle Huppert,
s’improvise en professeure de français avec une technique de mémorisation linguistique
novatrice : elle va faire naitre chez son élève une émotion intense (par une forme rhétorique
interrogative), puis translater le ressenti en mots, des phrases qu’elle notera sur un carton et
que l’élève devra répéter quotidiennement. C’est donc bien par la quête intérieure (un
sentiment d’échec, le deuil imparfait d’un père, la pitié pour son mari) que surgira
l’intégration cognitive, une translation de l’émotion au son, du ressenti au savoir. Inès
l’explique simplement, il est tout de même bien plus aisé d’intégrer une nouvelle langue par
ce qui nous bouleverse, plutôt que par la neutralité embarrassante des livres scolaires.
Comme toujours, et afin de mesurer la négativité des ressentiments (l’échec et la pitié), HSS
utilise ses instruments fétiches (la musique avec le piano et la guitare, la poésie avec ce
poète coréen disparu très jeune) pour tendre la corde entre le message et sa transmission,
et jouer de malice entre la délicatesse d’une note de piano et la genèse d’un conflit égoïste,
la beauté du verbe poétique et la violence d’un ressentiment de pitié. Mais il appuie là où il
est le plus brillant en s’abandonnant une fois de plus à sa maxime idéologique, que l’art sous
ses formes les plus mineures est source de transformation, qu’une simple partition musicale
peut faire naitre en nous la plus profonde des intériorisations, avec cette éternelle obsession
de l’épure, de la simplification du geste, de la recherche du mineure pour conquérir la
grandeur.
Que cachons-nous réellement derrière notre couche démonstrative ? Derrière « le
bonheur » que l’on avance à tout bout de champ ? Car derrière un morceau de piano ou de
guitare, et la fausse fierté d’en avoir été capable de le jouer, se cache la frustration. Celle de
ne pas être à la hauteur, « fatigué d’être quelqu’un d’autre » (comme l’exprime
littéralement Inès). Et derrière son propre échec, son incapacité à pardonner, un mari qui n’a
jamais été à la hauteur pour l’une, un père disparu trop tôt pour l’autre. Car dans l’anti-
chambre de la conscience se morfond le démon de la culpabilité, petit vaurien dévorant les
espaces et le temps, sourd, et pourtant tonitruant dans le développement d’une
personnalité souvent construite autour de notre incapacité à pardonner, à se pardonner. Et
ainsi, transposer aux autres notre propre sort dont on ne s’est jamais résolu à confronter.
Que cette façade est bien sombre chez un HSS que l’on a connu bien plus ingénu. Dans ce
même angle, il y a ensuite l’incapacité du colocataire de Inès à positionner ses pieds à plat,
jamais à égal, métaphore criarde d’une dysbalance de conscience incapable d’une mise à
zéro. Comment être alors celui que l’on est ? Après avoir porté l’estocade de la thèse, HSS
nous livre sa réponse.
Faire fi du passé. Car on ne sait rien de Inès, personne ne connaît son histoire, son passé, les
raisons de son installation à Séoul. Sa présence est délibérément dénudée de piste narrative,
Huppert est par ailleurs merveilleuse en ange volatile, en fantôme de l’espace, nous
poussant même à nous interroger sur sa réelle existence physique (lorsqu’elle disparaît d’un
parc en laissant bouche-bée ses interlocuteurs). Car pour HSS, la recherche de l’éveil
personnel passe par la sincérité, c’est à dire vivre en fonction des faits présents, porter le présent à sa plus grande hauteur, vivre le présent, juger du présent, et non ressasser un
passé qui est ce qu’il est, disparu. La très forte confrontation entre le colocataire de Inès et
sa mère en est le parfait exemple : elle est inquiète que son fils cohabite avec une
« étrangère » dont on ne sait rien, et invective son fils à l’interroger, une mère qui ne parlera
jamais au présent, un temps qu’elle réfute, et qui ne l’intéresse pas. Autre exemple parlant,
la séquence de comptabilité où la mère additionne les dépenses de son fils en petit calcul
d’apothicaire, avec ce désir de contrôle et de projection cette fois-ci dans le futur, sans
jamais s’ancrer dans un présent décisif. Inès, attendant à la porte, ne souhaitant pas
interagir avec cette mère malveillante, préférera alors l’absence à la confrontation. Que
nous dit donc HSS, et bien qu’un individu ne peut être ramené systématiquement à son
passé, qu’il est un poids trompeur, un biais de jugement, et que l’épanouissement passera
forcément par l’émotion « réelle », celle de l’instantané, et que l’on aime ou que l’on rejette
cette Inès (qui reste un personnage ambivalent, parfois jouant dangereusement avec une
forme de manipulation), son passé ne sera jamais juge de ses actions présentes. Et la
conclusion du voyage de cette « voyageuse » se fera forcément dans l’apaisement, le corps
allongé sur une roche, déconnecté de quelconques enjeux.
Hong Sang-soo par ses facilitateurs (poésie et musique) nous rappelle que l’émotion est
vecteur de savoir, que l’apprentissage se fait d’abord par le cœur, et que le passé ne définira
jamais qui l’on est, mais c’est bien un présent élagué des conventions arbitraires (l’égo,
l’argent) qui le fera. Inès/Huppert, être volatile qui nous invective à être celui que l’on est,
sans prétendre à jouer celui que l’on devrait être.