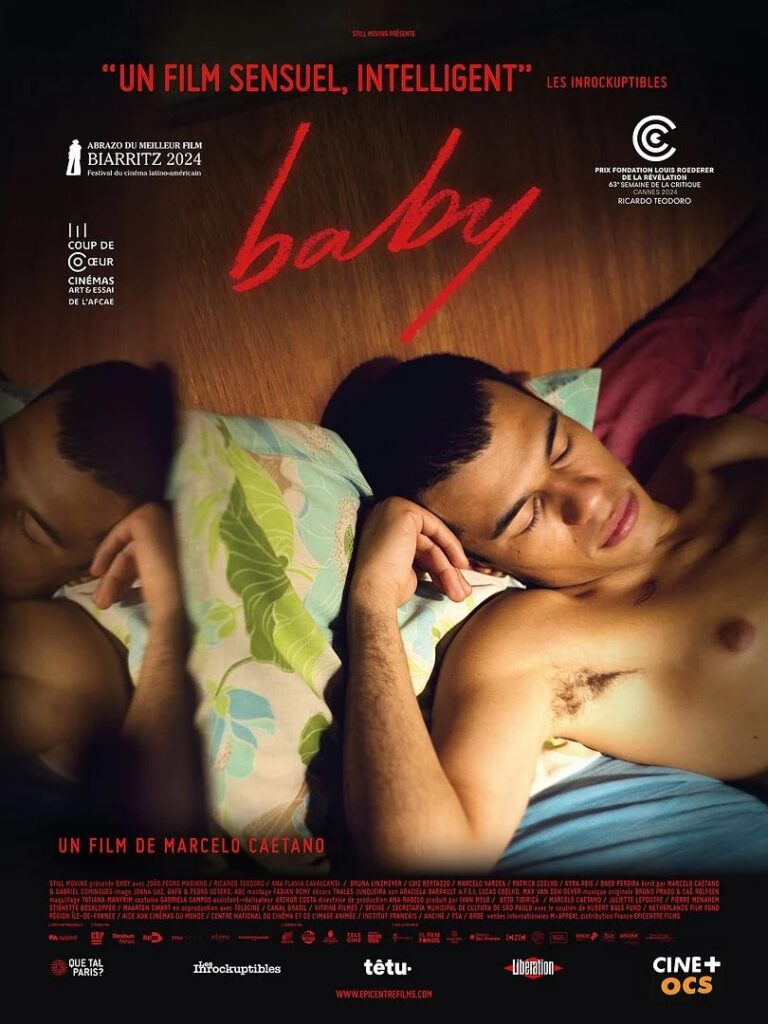La critique est à retrouver dans Culturopoing
Le diable se cache dans les détails. Ou comment la suggestion d’un patriarcat « ordinaire » inonde chaque plan de « Good One » en évitant consciencieusement la confrontation, pour appuyer, un peu plus, la violence de sa pesanteur, et le règne du silence déphasé. Là où Coralie Fargeat nous abreuve d’hectolitres de féminisme de pacotille avec « The Substance », Donaldson s’y oppose en choisissant la « fausse » mesure, le calme apparent d’une nature qui devrait être en pure logique guérisseuse, mais qui, à l’image d’une féroce plante carnivore, se refermera brutalement sur Sam, bien esseulée au milieu des pérégrinations bas-du-front des hommes qui l’entoureront tout au long de cette randonnée en guise de chemin de croix patriarcal.
Le film semble au départ se jouer de lui-même, répéter des codes bien ficelés d’un cinéma indépendant américain prédictif avec ses grosses ficelles d’une recherche d’un doux-amer piquant, le fameux duo « sundancien » bizarrerie et mièvrerie. La musique est jazzy, Sam et son père en pleine préparation de leur randonnée, et l’on s’imagine facilement un énième film sur une relation filiale tortueuse. Puis très vite, les visages nous parlent. Et l’on comprend rapidement que Sam va devoir faire face à une combinaison grotesque de machisme, victimisation masculine, moralisation outrancière et gaslighting. Son regard que l’on pensait abattu par la flemme d’un week-end sans ses amis viendra finalement du déversement d’absurdité de son père, Chris, et de l’ami bourru de son père, Matt, les ayant rejoints pour la grande aventure. Le regard de Sam qui croisera celle de la caissière d’un supermarché de bord de route en réponse à une ânerie de Matt sur le thème « il faut se faire plaisir » présage de la suite, ce n’est que le début du calvaire. Il y a dans ce court échange de quelques secondes entre Sam et la caissière une forme de sororité télépathique en ultime geste de bienveillance avant le tunnel. On y retrouve même un code horrifique de slasher dans la caméra de Donaldson, le fameux dernier contact avec la réalité (souvent d’ailleurs dans une supérette du genre en bord de route) avant la plongée dans la forêt mutilatrice d’ado. De manière purement métaphorique, Sam va bien devoir faire face à une mise à mort, celle du si peu d’innocence qui lui restait.
Sa position géographique est perpétuellement questionnée dans le film, dans la voiture, traitée d’espionne et rabattue au siège arrière, dans l’hôtel, préférant rester au sol que de dormir entre Matt et son père, dans la tente, où elle ne semble jamais avoir sa place. En revanche, elle a une place toute trouvée autour du feu, à devoir préparer le diner. Donaldson interroge ainsi la question de l’espace, celui circonscrit par l’homme, écrasant l’espace vital féminin, la réduisant à l’engoncement, au malaise, et au mutisme. Il y a cette violente scène où une bande d’amis vient littéralement envahir l’espace commun du feu de camps entraînant automatiquement le retrait de Sam en périphérie, totalement déconsidérée, ne pouvant alors que sourire sans parler, tout en subissant les anecdotes machistes et déplorables qui se succèdent. L’acquiescement semble automatique, inné, un masque social pour cacher son dégoût. En revanche, chez Matt et Chris, les masques tombent. Que ce soit le père de Sam ou son ami, les deux sont empêtrés dans des divorces qu’ils ne mesurent pas, incapable d’élever leur point de vue égoïste, ils s’enferment dans une victimisation déplorable, un acharnement sur leurs femmes, et des larmes brûlantes d’enfants immatures. La seule voix qui s’élève avec intelligence est bien celle de Sam, à peine 17 ans, et devant – déjà, jouer le rôle de mère protectrice auprès de ces pauvres agneaux blessés. Puis être irrémédiablement ramené à sa condition féminine juste après (« Tu es futée toi ? »). Il y a chez ces deux hommes un handicap émotionnel inhérent à la construction patriarcale, une incapacité analytique de l’émotion, de la compréhension de l’autre, un narcissisme pervers et autocentré qui ne lit pas la souffrance de la femme, pour se refermer sur sa propre douleur, si intense soit-elle. Donaldson décide alors de pousser le curseur jusqu’à l’ignoble. En une phrase, elle fait basculer la bêtise dans la perversité. Chris propose à Sam de venir le réchauffer sous sa tente. Et ce silence qui s’en suit est mortel. Les silences qui suivront le seront tout autant, comme celui d’un père minimisant, et fermant les yeux.
« Good One » est un film désespéré, une mise à mort définitive des relations hommes femmes par le poids d’un patriarcat ne laissant aucune place à l’espoir d’un équilibre, tout y est déséquilibré, jusqu’au mépris, la déconsidération, jusqu’à la perversion, la dépravation intellectuelle, il n’y a ici aucune place à la discussion, au débat, aucune place à la médiation. Il y a la fuite (comme celle de Sam en conclusion), le jugement en silence (et ce dernier plan regard contre regard face à son père), mais il est trop tard pour l’éducation. Car une femme est une femme, ni un être maternel, ni un objet sexualisé, ni un sous-homme. Et à travers cette constellation de toxicité, Donaldson nous interroge violemment : changeront-ils un jour ?