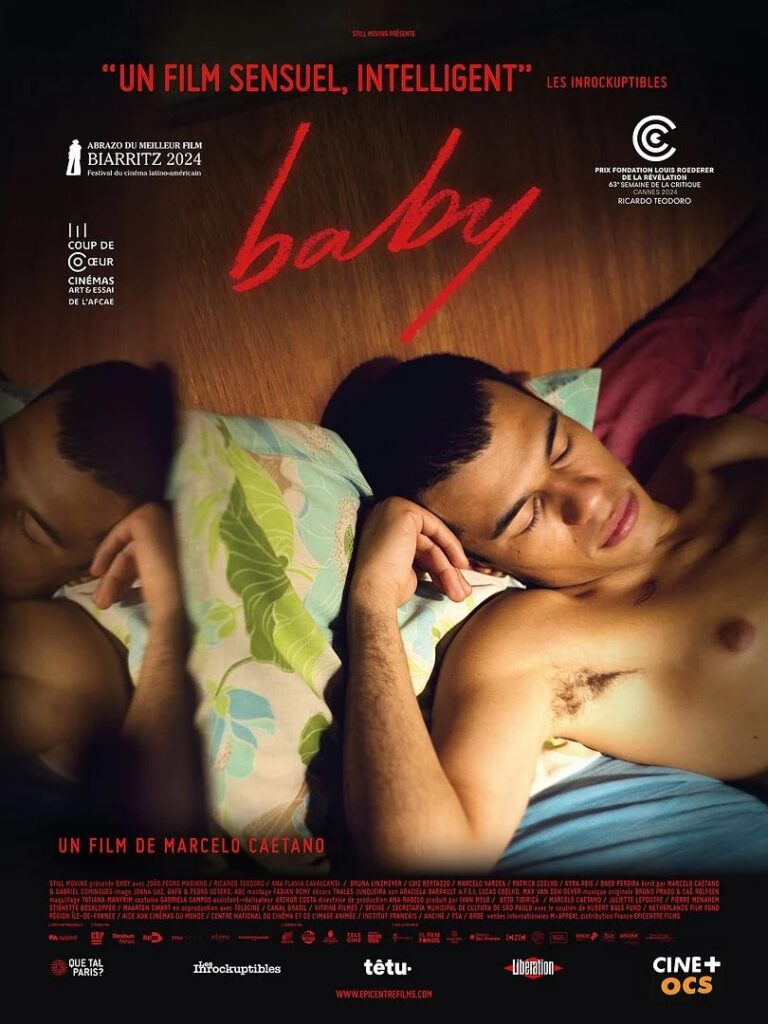La critique est à retrouver sur Culturopoing
Il y a assurément quelque chose dans ce premier film belge passé par la Semaine de la critique cannoise en 2023, un drame social qui ne se vit non pas simplement à travers une théâtralisation à outrance et son attrait lacrymal si en vue chez Ken Loach, mais surtout par la retenue et l’exigence d’une mise en scène à bonne distance. Paloma Sermon-Daï trouve ici le point d’équilibre entre l’ancrage territorial réaliste (les deux acteurs Purdey et Makenzie Lombet sont tout comme dans le film frère et sœur dans la vie) et un ton fictionnel résolument métaphorique, ce va-et-vient élève le film bien au-delà de sa simpliste identification de « film social ». Va s’y nicher une poésie de l’ordinaire, ou plus exactement, de la souffrance ordinaire, celle qui échappe aux gros titres de presse, qui désintéresse la classe politique, ce ventre-mou mutique et sa détresse invisible. Et avec cette pauvreté rurale, son « plafond de verre », cette frontière qui emprisonne le pauvre à sa condition de pauvre, lui interdisant pernicieusement l’accès à l’éducation et à un avenir différent de celui attribué arbitrairement à sa naissance. Même l’imaginaire semble ici consigné (lorsque qu’un ami de Makenzie s’interroge en observant le ciel si celui-ci à une hauteur maximale à ne pas dépasser), la vitre fissurée de la maison, grand enjeu du film va venir à la fois rapprocher le frère de la sœur, puis séparer le frère de son ami et symboliser la condition précaire d’une famille giflée par les gouttes d’eau qui s’y infiltrent. Une nouvelle affaire de vitre jaillira lorsque Purdey finira par devoir les nettoyer ces vitres, son rêve de devenir infirmière rattrapé par son travail saisonnier (femme de ménage dans un camping) : cet été brûlant qui devait être source de jeu et de joie, d’oisiveté adolescente à faire tout ce qu’il ne faut pas faire, sera finalement pour Purdey et Makenzie une entrée fracassante dans la violence d’un monde adulte qui depuis longtemps a cessé de rêver. Et qui jamais ne devrait amarrer si tôt la vie d’un adolescent en proie au doute et à la connerie légitime.
Le poids de la défection parentale (la mère qui disparaît, le père inconnu) va entrainer Makenzie, 16 ans, à la petite délinquance (vol de vélo et d’alcool, racket), son futur scolaire déjà compromis par une décision de son lycée de le renvoyer. A ses côtés, Purdey bientôt majeure (elle ne cesse de le répéter) doit assumer l’entièreté des responsabilités financières. Il n’y a ici aucune empathie mal placée chez Sermon-Daï, pas de bon sentiment élitiste mais plutôt un regard documentariste sur le tragique d’une situation finalement bien plus ordinaire qu’extraordinaire, avec un constat cinglant, celui d’une inégalité systémique, insoluble, qui isole les plus démunis dès le plus jeune âge en hiérarchisant les strates sociales uniquement en fonction du potentiel financier. Il y a cohabitation, mais jamais d’intégration (le petit copain de Purdey Youssef, le gosse riche que va agresser Makenzie, les filles du bord de lac). Quoi que l’on puisse en dire, l’égalitarisme des chances avec l’accès à la scolarité pour tous est une illusion, le discours nauséeux de Youssef en est le parfait exemple : lui le petit bourgeois bien né à sa route toute tracée vers les grandes écoles, et prévient Purdey qu’il ne restera pas avec une simple femme de ménage, l’invectivant à réagir. Mais a-t-elle le choix ? Ont-ils le choix ? « Il suffit de traverser la route pour trouver du travail » comme dirait l’autre. La maison tombe en ruine, le père n’existe pas, la mère a disparu, il n’y a pas à bouffer dans le frigo. Le constat est sans appel, une société qui ne protège pas les plus faibles les emprisonne automatiquement dans une cage prolétaire où les rêves n’existent plus, l’émancipation annihilée au rang du désœuvrement et de l’ignorance. L’école tourne le dos à Makenzie, l’avenir d’infirmière de Purdey est incompatible avec leur survie financière : le temps semble s’être arrêté, l’insouciance de l’été rattrapée par la terrible vérité d’un avenir obscurci.
Mais le film n’est pas si cafardeux, et offre même à sa toute fin une délivrance passant par la mise à mort salvatrice du spectre maternel. La mère disparue tout le film est de retour, inerte, plaquée au sol, dans une forme on l’imagine de coma éthylique, la scène glaçante semble étrangement familière à Makenzie, il la porte jusqu’au lit, puis la couche. La situation est d’une inacceptable normalité, le rôle parent-enfant s’est inversé. Un dîner fait suite à ce retour, le silence est pesant, les regards sont abaissés, les jeux et vannes du premier repas en début de film ont disparu, cette puissante scène mutique signe définitivement la fin d’un chapitre, rien ne sera jamais plus comme avant. Pour Makenzie et Purdey, il est temps d’avancer : ils quitteront cette maison qui fuit, ce passé qui pleure, ce présent bousillé et sans avenir, leur destin, il se le construiront en cicatrisant ensemble les blessures indélébiles d’une mère indigne, et avec elles, la honte du déclassement social.
Sermon-Daï réussit à s’immiscer dans cette étroite interstice entre le social, le réel, et l’ambition artistique d’une poésie de la douleur, un film sincère, tenu et retenu, où de la détresse jaillit l’espoir d’un avenir différent, certes pas révolutionnaire, mais peut-être un peu plus égalitaire.