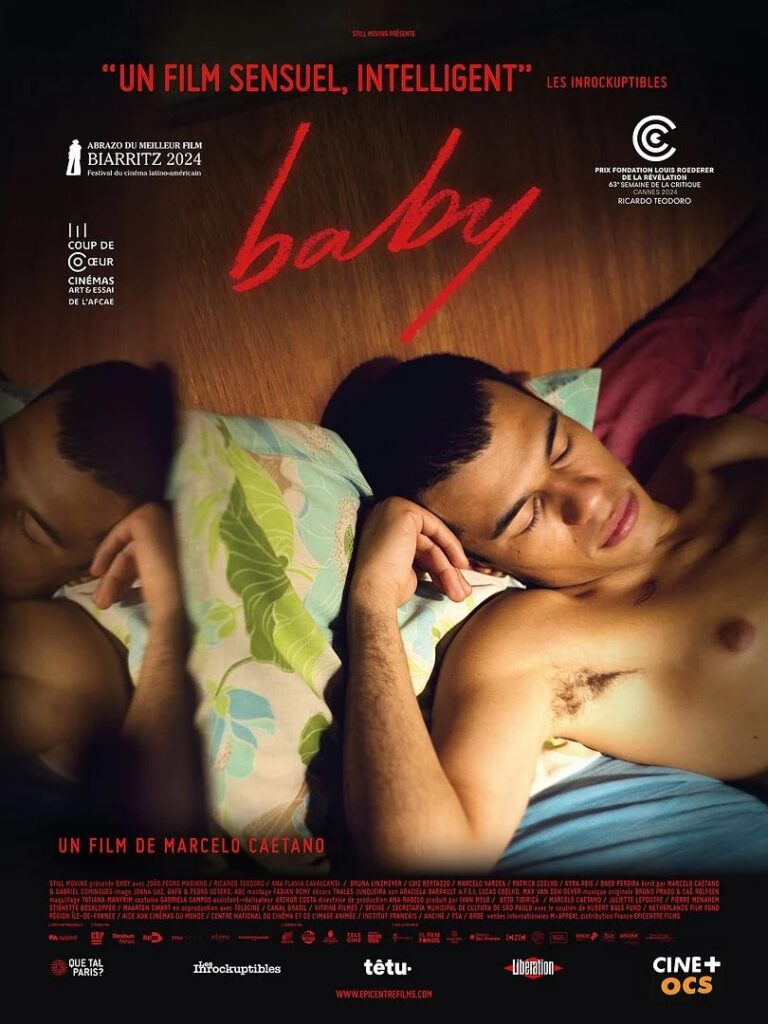La critique est à retrouver en intégralité sur le site de Culturopoing.
Que l’on apprécie ou non Alice Rorhwacher (Corpo Celeste, Les Merveilles, Heureux comme Lazzaro), il est indéniable que son univers baroque déborde du cadre, joue avec le conventionnel pour détourner notre regard usé par l’habitude des formes cinématographiques vers une marge atypique, un beau bizarre qui détonne, une singulière capacité à l’entremêlement des formes, la théâtralité, le burlesque, la poésie lunaire, le fantastique qui jaillit du réel, la candeur songeuse de Fellini, l’ardeur terreuse de Rossellini dont Rorhwacher clame régulièrement son amour. Et c’est aussi ça la marque des grands cinéastes, et Alice Rorhwacher en est indéniablement une, sa rétrospective au Centre Pompidou en cette fin d’année attestant son emprise sur un jeune cinéma italien qui patauge encore à s’extirper des monstres du passé (Bellocchio et Moretti, toujours au sommet cette année avec respectivement L’enlèvement et Un avenir radieux) : une signature formelle et narrative unique. Et dès cette ouverture somptueuse, La Chimère, et derrière elle le regard de Rorhwacher nous impose toute sa grâce avec le portrait de cet homme endormi, ange crasseux au costume blanc cassé tâché, rêvassant la tête apposé à la vitre d’un train. De par sa morphologie atypique (la rondeur de ses traits et sa très grande taille), l’on comprend qu’il est un étranger (anglais), un bohémien paumé au milieu de cette campagne italienne reclus, les visages des femmes qui l’entourent sont eux géométriques, les nez dessinés et proéminents qui lui rappellent ceux des Etrusques, cette civilisation pré-romaine dominante, et leurs fameux visages profilés sur les jarres anciennes, une première source d’appel à son obsession pour les antiquités.
Rorhwacher plante le décor d’une Italie abandonnée, mortifère, qui ne vit qu’à travers l’illustre de son passé, et qui refuse de voir l’effondrement de son présent : il y a cette campagne désertifiée, un village fantôme qui ne donne signe de vie qu’à travers l’Epiphanie et son carnaval sur tracteur, la maison de Arthur est faite de taule, adjacente à des fortifications usées, un château de famille renvoie à une grandeur passé, mais l’eau s’y infiltre, et les bassines jonchent le sol pour éviter l’inondation, la mer est crasseuse, les usines s’y sont installés, la gare ferroviaire abandonnée. Et au milieu de cette désolation, une galerie de sales gueules féliniennes entourent Arthur, des bras-cassés pilleurs de tombes qui ne s’accointent avec lui que pour son don de « sourcier », et cette prédisposition magique à dénicher les tombes antiques à l’aide d’un bout de bois qui vacille. Qu’y-a-t-il d’autre à faire que de déterrer le passé et saccager la mémoire ancienne lorsque de futur il n’y a pas, que tout espoir semble dissolue dans un marasme dépressif : il n’y a pas d’avenir pour cette bande de fossoyeurs, hormis celui de vendre au marché noir les beautés enfouîtes du passé. Il est là le versant tragique de La Chimère, malgré l’allégresse, les rires gras, l’anarchisme sous-jacent, la galère est partout, tout le temps.
Le film aurait pu basculer dans la caricature et la farce, un regard mesquin et moralisateur qui aurait pu tuer l’avenir du film. Mais arrive alors Beniamina, ou plutôt sa représentation vaporeuse, celle la douceur de son visage que l’on voit apparaître lors du premier rêve de Arthur, celui du train, puis représentée (littéralement) par un fil rouge qui guidera tout le film. Sa présence est un marqueur indispensable à l’équilibre bringuebalant d’une mise en scène ne cessant de jouer à contre-temps, multipliant les césures poétiques, les silences et absences laissant le rêve et l’à-peu-près rompre avec le classicisme de la mise en scène italienne bellocchienne, Rorhwacher inverse les images, met son héros, son Arthur (tant ce personnage semble appartenir à sa génitrice) la tête en bas, bouscule les codes non pas par jeu accessoire, mais par soucis de la différence. Mais Beniamina qui est-elle ? L’amour perdu de Arthur, cette femme dont on ne sait rien, mais dont sa présence fait tout, elle que l’on pensait au départ simplement perdue (Arthur expliquant à sa mère ne pas l’avoir retrouvé en début de film) mais dont sa mort tragique nous fera rapidement face et sera à l’origine du deuil impossible de Arthur et de son incapacité maladive d’avancer, sortir « la tête du trou » dans une forme de toxicomanie amoureuse.
En effet, le parallélisme à la toxicomanie, quel qu’elle soit d’ailleurs, est criante, de sa sortie de prison et son refus de « revoir les amis » pour ne pas replonger auprès de ceux qui l’ont fait chuter jusqu’au retour aux affaires et son implacable logique. La quête du « produit » en obnubilation (vases, sculptures, accessoires antiques) en porte ouverte de l’oubli, sa recherche insensée et incessante de tombeaux, ces crises de « lucidité » et son bâton qui s’agite métaphore du désir incontrôlé. Et comme dans toute dépendance, il y a l’espoir de sa sortie, cet espoir c’est Italia, une jeune brunette aux cheveux frisés, la fraicheur incarnée et le regard rempli de bienveillance. Elle qui lui fera comprendre la dégueulasserie de ses actes, jusqu’à réussir l’impensable, le détourner de l’appât du gain pour une prise de conscience indispensable à son salut. Et cette prise de conscience sera tonitruante dans le film avec le jet dans un lac d’une tête d’une sculpture au prix exorbitant d’un un lâché prise bouleversant. L’espoir renait, Arthur embrasse enfin Italia, et s’installe dans un squat de la gare désaffectée avec elle et un groupe de femme au pouvoir, l’allégresse est revenue, la joie et le jeu. Mais le propre de la toxicomanie, c’est aussi la rechute. Celle-ci sera fatale, et plongera Arthur de nouveau dans les méandres obscures et incontrôlées de cette chasse au trésor absconde, le conduisant inévitablement là où il n’a cessé de vouloir aller, de l’autre côté (« l’au-delà » dans le film), celui du ciel et des disparus.
La Chimère, ce sont ces allers-retours ininterrompus entre terre et ciel, le passé et l’absence de futur, une beauté plastique foudroyante, une multiplicité des formes qui n’a comme seul et unique but, celui de faire émerger malgré toutes les farandoles accessoires de mise en scène, le lien indéfectible entre l’aimant et l’être aimé, ce lien, ce fil infrangible menant Arthur à Beniamina aux cieux des amours éternels.