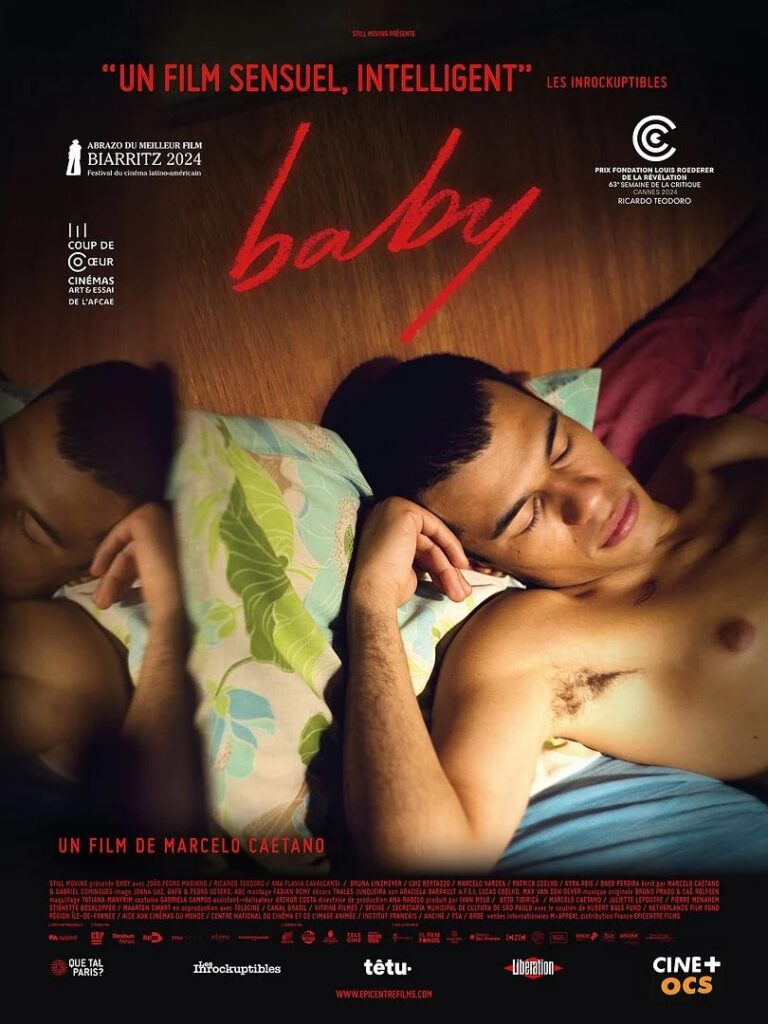La critique est à retrouver sur le site internet de Culturopoing
Dès son ouverture, les enjeux territoriaux au cœur du premier long-métrage du chilien Felipe Gálvez Haberle, prix de la critique internationale au Certain Regard du dernier festival de Cannes, sont filmés par des barbelés entrecoupant de manière purement arbitraire et surtout aberrante l’immensité vierge et naturelle des espaces fordiens de la Terre de feu du sud du Chili. Nous sommes en 1901, l’absence et le silence sont rois, la population autochtone indienne est dispersée, et le riche propriétaire de ces terres, José Menendez, dont on ne saura jamais réellement l’origine de ces acquisitions obscures souhaite « nettoyer ses terres » et ouvrir une voie d’accès vers l’Atlantique dans une « chasse à l’indien » mené par trois cavaliers au relent apocalyptique : le cow-boy anglais ex-soldat britannique, le yankee moustachu et « le métisse », mi-chilien mi-indien, source de conflit (« on ne saura jamais sur qui il tire »), lui qui s’oppose en silence et au perçant de son regard noir à la décadence et la violence décérébrée des deux occidentaux. De ces grands plans larges à la tonitruance de sa bande-son (formidablement composée par Harry Allouche), la mise en scène à des touches kubrickiennes lorsque Gálvez arrive à saisir l’importance de l’enjeu, cette guerre terrienne complètement étranger aux autochtones (« les indiens ne comprennent rien à la propriété ») prenant alors une importance absurde dans ces paysages vierges de civilisation où se bagarre littéralement des damnés édentés, abandonnés (on pense à cette scène avec des argentins, et ce concours de bras-de fer et de lutte) qui dans leur perdition espère retrouver une forme de grandeur en s’imposant sur le rien, cette nature immuable, magistralement dominatrice, filmée en aquarelle, dont le concept même de propriété est un non-sens. La photographie picturale atypique, granuleuse, offre une dualité saisissante, tout comme sa mise en scène, avec l’apposition de ses plans larges sur les terres sauvages face à la petitesse et la cupidité des hommes, la sérénité des indiens (notamment celle du métisse, et cette très belle scène du regard œil contre œil avec un cheval) face à la déchéance blanche.
Une forme philosophique se dessine tout le long du film, nous rappellant instantanément Terrence Malick, et notamment l’ouverture de son premier film (Badlands) lorsque Martin Sheen en éboueur se propose de « manger le chien mort », sa carcasse retrouvée au bord d’une route. Cette séquence sera d’ailleurs un marqueur source du transcendantalisme malickien qui suivra toute sa filmographie. Et c’est ce même transcendantalisme que l’on retrouve chez Gálvez avec cette notion d’absorption de la matière, l’anglais McLennan racontera une expérience de survie durant laquelle lui et des camarades militaires ont dû manger leur cheval mort pour survivre, l’américain parlera lui de « manger la mer », jusqu’au final, où l’on apprendra les atrocités de ces 3 cavaliers de l’horreur, qui ont empoisonné une baleine échouée afin d’exterminer une centaine d’indiens après qu’ils aient ingéré le mammifère infesté. Cette notion transcendantale frappante s’intègre logiquement au rapport lumineux de Gálvez à la notion de « territoire » à l’instar du grand manitou Ralph Walder Emerson, persuadé que l’humain est corrompu par les institutions et que son épanouissement ne peut passer que par l’indépendance des êtres. Et c’est bien là tout le message et l’enjeu des Colons, l’appropriation culturelle et terrienne effaçant l’autonomie des peuples, et donc, la destruction progressive et automatique de la balance nature/humain. En effet, de l’appropriation terrienne s’associe l’appropriation culturelle, un bourgeois occidental s’émeut de la forme du crâne d’un indien, invectivant le fait qu’il devrait être tous « docteurs ou avocats », destiner leur futur, commanditer leur avenir dans une assimilation coloniale vomitive.
De son versant philosophique basculons vers le politique, le parallélisme entre ce riche propriétaire Mr Menendez et le dictateur Pinochet se fait certes aisément mais subtilement. Cette extermination de l’opposition, la mise à l’oubli des atrocités, les trahisons et mensonge étatique, la violence omniprésente, la mise en scène de conclusion et cette scène du maté et des costumes traditionnels pour tenter de cacher l’horreur, le film daté du début du XXième siècle n’a jamais semblé aussi contemporain, presque anachronique lorsque le politicard débarque pour détourner la vérité dans la scène finale. Gálvez fait également un autre parallèle avec l’histoire contemporaine chilienne, la privatisation outrancière des terres, les politiques vendant aux plus offrants leurs plus beaux trésors (notamment dans le désert d’Atacama dans le nord du pays), destituant leur propre pays des richesses inestimables de leur sol en expulsant les peuples indigènes (on pense au Mapuche, cité dans le film, qui ont eux toujours résister à l’appel de l’argent, s’interdisant de quitter leur terre qu’il considère comme leur Mère).
Des scènes reste gravées, notamment celle de l’attaque surprise d’un camp indien endormi, la brume cache l’horreur, les coup de fusils résonne dans le silence assourdissant, les hurlements s’éteignent par le bruit des chutes au sol, le cauchemar d’une exécution sournoise et lâche. Et il y a le métisse, incapable de tuer, ni son propre sang, ni celui de ses ennemis, il vise même McLennan, mais n’arrivera jamais à l’exécuter. Plus tard, il sera incapable de profiter d’une femme prisonnière, à terre et en pleurs, qu’on lui demande expressément de violer. Il préférera la tuer, comme l’on abat un cheval sur un champ de course, et mettre fin à l’inimaginable de ses souffrances. Il y a ici une réussite formelle époustouflante à filmer la détresse et l’effroi par la retenue.
Il y a un vrai exploit avec Les Colons, celui d’éviter l’écueil d’un premier film (trop en faire), instaurer un climat unique, une réussite formelle indiscutable, et une immensité de propos naviguant entre la férocité de son message politique et une poésie philosophique transcendantale qui fait naitre une poésie de l’effroi, une beauté dans l’inhumanité, un film sombre à la lueur du désespoir.