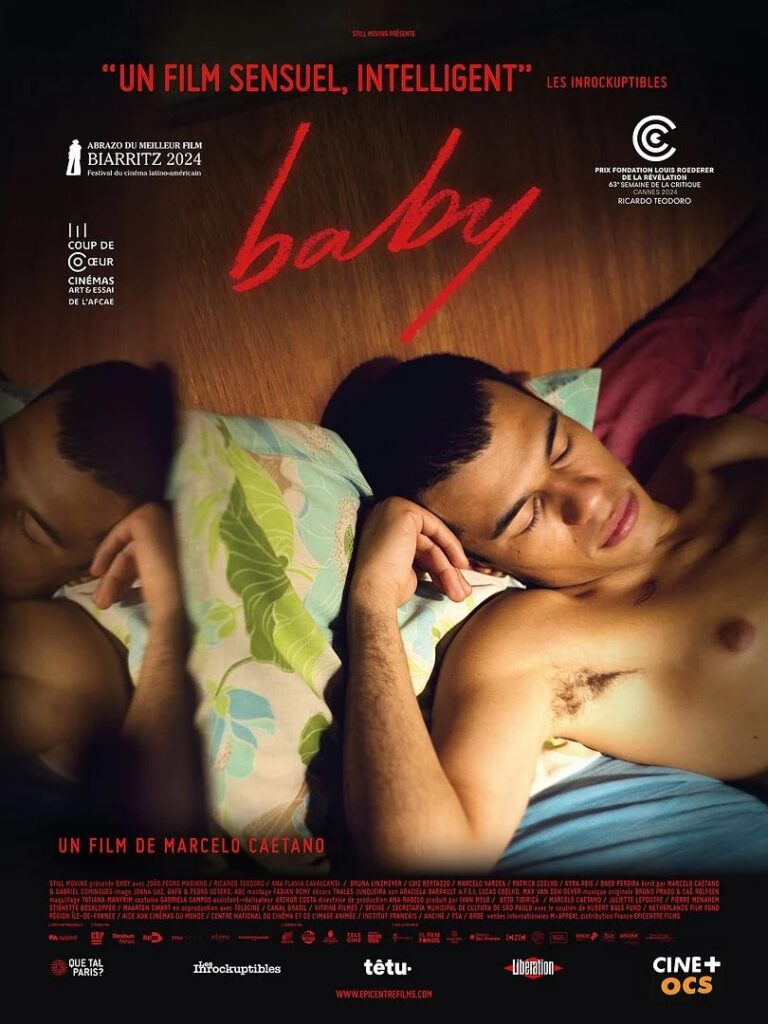La critique est à retrouver sur Culturopoing.com
Une page Word vierge et blanche ouvre « Ma vie, Ma gueule », Agnès (Jaoui) interprète Sophie (Fillières) dans un film testamentaire jonché d’oublis, de regrets éternels, de joies aussi, et d’absurde, l’absurdité de la mort, de sa propre mort dans un déchirant exercice de mémoire. Ultime film à sortie posthume (et ouverture de la Quinzaine des cinéastes cette année), « Ma vie, ma gueule » nous parle donc de la mort, mais surtout, de ces instants sacrés qui la précèdent, ce temps d’absence où la mémoire déraille, perdue dans un épais brouillard d’un esprit qui divague. Et quel esprit, celui d’une grande cinéaste, son panache du verbe, du retors, d’un sens inné du rythme et de l’écriture (on pense à « La Belle et la Belle » et son jeu sur les âges, ou d’une autre âme en peine, celle d’une femme psy dans « Gentille »). Ce temps pré-mortem, Sophie Fillières y a navigué de longues années, atteinte d’une maladie grave non divulguée qui finira par l’emporter en juillet 2023. Et c’est dans ce pesant contexte que vient se nicher la beauté foudroyante de « Ma vie, ma gueule », une simplicité à tomber, un au revoir fait de jeux et de mots, de querelles enfantines, d’oublis, beaucoup, et du désir impérieux d’un départ en toute dignité. Il y a ici un sentiment merveilleux d’apaisement, de grâce, un au revoir humble et discret (comme ces miraculeuses apparitions de Philippe Katerine) qui impose un fichu respect.
Barberie Bichette (que l’on surnomme pour son plus grand déplaisir Barbie), fausse publiciste et vraie poétesse quinquagénaire s’empêtre devant un reflet qui ne cesse de se distendre, le sien face à son miroir (qu’elle saluera d’un doigt d’honneur), engluée dans une vie de solitude, d’un temps qui passe, d’une fille trop jeune, d’un fils trop loin, et l’ennui de journées trop longues. Fillières joue des poncifs de l’âge dans une forme de renoncement de l’autre et du tout, du travail dont elle se moque allègrement (Barbie doit trouver un nom pour une barre de céréales à trou, elle ira plutôt apposer une petit poème coquet sur le paper-board), de la famille (Valérie Donzelli en sœur distante, ses enfants qui l’ignorent), du physique (et cette drôle de scène inversée de la salle de sport, entre l’acte et le mot). Mais surtout, une ambivalente lecture de la mort, source à la fois de raillerie (« Tu as déjà pensé à combien de douches tu vas prendre avant de mourir ? ») et de brutal constat (« Je n’ai pas le temps de mourir »). Cette mort porte un nom pour Barbie, celui du commun, elle s’appelle Bertrand, elle le prend pour la faucille, alors qu’il n’est qu’un très vieil ami d’enfance dont elle a oublié le visage. L’amnésie la gagne, le vertige du shut-down, un cerveau qui dit stop. Elle est à terre, persuadée que ça y est, c’est la fin. Et pourtant, ce ne sera qu’un début, celui de la reconstruction, pas à pas, dans une institution psychiatrique.
Miracle que Agnès Jaoui et cette fragilité désarmante, cette sensibilité incommensurable, ce sens inné de la rupture jouant la culbute entre la drôlerie et le cynisme (et comment ne pas repenser avec tendresse à son comparse de toujours Jean-Pierre Bacri), la tentation du bon mot face à celui du mot juste, elle qui ne se prend jamais pour une autre, mais surtout pour personne. Agnès, Barbie, à l’unisson de la guérison, et ce long passage en hôpital psychiatrique bouleversant d’une tendresse rêche. La dureté de la maladie, mais la beauté du combat, cette guerre intestine entre la folie et la conscience, jusqu’à s’interroger sur le sens même de cette dichotomie : le psychiatre (et ce nœud papillon bouffant) n’est-il pas le vrai fou dans cette histoire face à la sensibilité poétique et magistralement consciente de Barbie ? Preuve à l’appui, cette merveilleuse sculpture en glaise d’elle-même bâtit par ses mains et qui a su redéfinir son passé, et lui ouvrir les portes d’un futur, encore possible, auprès de sa seule fierté imagée du film, ses enfants (ndlr. Les propres enfants de Sophie Fillières ont présenté le film aux avant-premières cannoises et au FEMA de La Rochelle) Ce qui définit Sophie Fillières est donc là, impassible, à chaque scène elle domine par la pertinence de son écriture, et cette majestueuse capacité à tout inverser, le plus commun (un tapis de course par exemple) devient un imaginaire de l’absurde, l’errance mentale une poésie du silence et de l’instant, l’amnésie une source d’humour, de rire paradoxal, une irréflexion à ne surtout pas se prendre au sérieux, alors que tout ne cesse de l’être : rire et jouer de la maladie, pouffer de la mort, sans jamais tomber dans une vulgarité provocatrice, il y a là un équilibre affolant de maitrise.
Comment bâtir son autobiographie sur la morne plaine des souvenirs oubliés ? Comment se souvenir sans pouvoir le faire ? C’est là où il y a filiation avec le dernier film de Hong Sang-soo (In Water). HSS tentait de se remémorer son passé mais dominé par l’oubli, il floutera l’image pour le rendre vaporeux. Fillières utilise quant à elle l’absurde, la galéjade et le jeu des mots en twist malin pour éviter la confrontation à la dure réalité d’un cerveau qui s’efface. Tout s’embrouille, et ce foutraque méli-mélo indécrottable fait de cette fragilité sa grande beauté. Jusqu’au lâcher-prise, l’envol et la fuite. Barbie a retrouvé sa liberté (elle est désormais sortie de l’institution psychiatrique), là voilà en Angleterre avec ses enfants. Mais cette escapade familiale ronronnant, ce n’est pas vraiment Barbie. Elle doit s’échapper, partir seule pour se confronter à son destin. Des souvenirs émergent, encore. Plus précis ceux-ci lorsqu’elle se souvient de cigarettes camouflées dans un livre chez une amie d’enfance. Et puis une idée de voyage qui surgit (d’un emballage papier de fish and chips), une terre libertaire au fin fond de l’Angleterre, là où il n’y a rien à voir (comme la prévient son amie), mais tout à trouver. Barbie devient Lady Bichette (en achetant une parcelle d’une terre vierge, vierge comme la page Word en ouverture), et sur son chemin, le ukulélé de Philippe Katerine pour conclure, avec humanisme et grandeur, la foudroyante beauté d’un passage, celui du monde des vivants au monde des morts. Et en son sein, une éternelle et si talentueuse cinéaste qui a su dire et filmer si bas ce que tout le monde pense si haut.