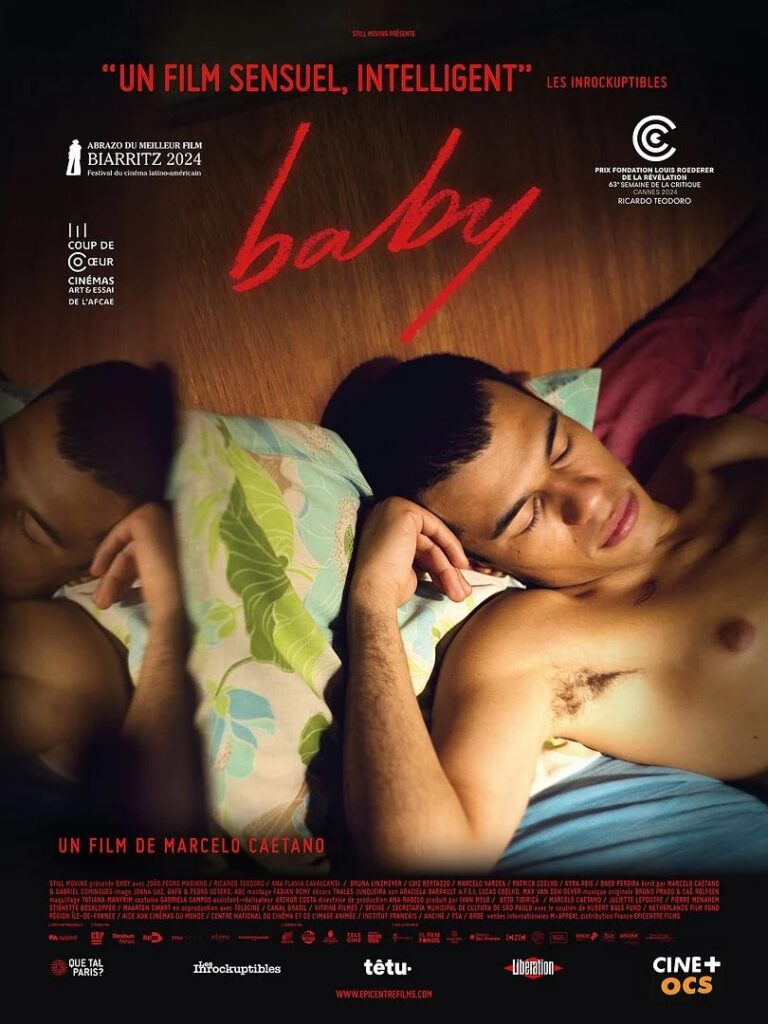La critique est à retrouver dans Culturopoing
Il y a des films qui emportent tout, la raison elle-même, où l’analytique devient dangereusement accessoire, l’émotion envahissant alors l’intransigeante barrière entre une œuvre et l’amour pour elle. Mais n’est-ce pas là que vient se lover notre incommensurable amour pour le cinéma ? De facto, qu’il soit incontrôlé. Avant de le redécouvrir dans les meilleures conditions qu’il soit possible (en salle), j’ai découvert Tótem dans les pires. Engoncé dans mon siège économique, les écouteurs systématiquement trop larges pour mes petits orifices auriculaires, l’écran en taille livre de poche, c’est ainsi que m’a envahi Totem, dans un vol long-courrier pour Bangkok fin juillet. A reconsidérer la salle pour un écran portable ? N’exagérons pas, mais le film, à 10 000 mètres dans les cieux, m’a saisi, mes larmes ne cessant de couler, drainant avec elles, sa gêne associée, mes mains tremblotantes tentant bien maladroitement de cacher mon chagrin. Mais que s’est-il donc passé pour que Lila Avilés puisse conquérir à ce point mon cœur cinéphile rigoureusement mis à nu ?
Il serait trompeur, et franchement malhonnête de me lancer dans une étude socio-ethnologique comparative entre la réception de la mort en Europe et en Amérique centrale, je n’en ai ni les compétences ni les connaissances. Partons donc d’un principe clair, mon regard est celui d’un européen à l’éducation judéo-chrétienne où le silence, la pesanteur et la dramaturgie sont inhérents à ma culture de la mort, celle transmise par des générations passées qui, et malgré l’appel religieux à une forme d’immortalité (le paradis), ont systématiquement noué la mort à la fin, et donc à une peine infinie, une souffrance esthétique (le noir), dramatique (les pleurs), philosophique (le néant). Contrairement à ce que l’on peut communément penser, ce qui bouleverse est rarement ce qui nous « parle », mais bien plus ce qui nous oppose, la beauté de la différence, ce vertige qui secoue les tripes dans une autre forme de possible. La mort chez Avilés va libérer la parole, la fin fera naître l’humain, le toucher, fera jaillir le contact, nous qui nous nous efforçons à l’isolement et à la peine solitaire, Tótem nous ordonne de faire l’inverse. Libérer la spiritualité de l’au-delà plutôt que les litanies de bondieuseries qui ne parlent plus à personne, recentrer l’humain au milieu de la mort, plutôt que la souffrance aveugle, rappeler au mourant qu’il existe, ici et pour toujours à travers les rires d’une anecdote, le jeu et le spectacle, la chanson, une histoire ancestrale, « nourrir » la mort jusqu’à ce qu’elle redevienne ce qu’elle a toujours été, un simple passage, dédramatiser l’enjeu (souvent dramatiser par sa lecture religieuse), tout en la considérant comme essentiel, un point-virgule dans une entité qui nous dépasse.
Nous sommes au Mexique, le très jeune Tona, la quarantaine à peine, est à l’aune d’une mort programmée, le cancer le ronge, il refuse la chimiothérapie, et s’isole à l’étage lorsque toute sa famille s’affaire au rez-de-chaussée à préparer son anniversaire. Son corps avachi et écrasé par la maladie peut à peine se mouvoir. Avilés va alors se lancer dans un jeu de portraitiste d’allure franchement autobiographique, entre ses sœurs qui s’attardent à l’anecdotique pour cacher l’enjeu principal (un gâteau d’anniversaire, une séance chamanique), un père mutique (atteint d’un probable cancer des gorges vocales, il ne peut parler qu’à travers un vocoder, métaphore évidente de son incapacité maladive à libérer sa parole), sa femme volontairement absente pour que la caméra puisse se concentrer sur la miraculeuse Sole (interprétée par Naima Senties), ange solitaire au regard bouleversant de candeur et de gravité, une naïveté d’apparence (lorsqu’elle demande à Siri si son père va mourir), mais d’une maturité émotive déconcertante, antidatée. La disparition de son père est un fardeau, un fardeau qu’elle doit porter seule, dans la plus grande dignité, sans l’aide de quiconque, une mission divine et profondément spirituelle où scène après scène, sa solitude s’ancre dans une maison qui elle s’éveille (par les festivités dont elle refuse un temps de rejoindre). Elle s’isole, plusieurs scènes la faisant parler à elle-même dans une quête de vérité plus globale («Quand va arriver la fin du monde ?»), mais toujours profondément seule, rendant alors sa destinée tragique mais sublime, elle semble porter le poids du monde sur ses frêles épaules. Jusqu’à ce qu’enfin, l’équilibre arrive, et la réapparition de sa mère, qui, le temps d’un petit spectacle pour Tona, la hissera sur ses épaules pour ramener son enfance là où elle doit être, en apesanteur au-dessus du monde adulte. Sole peut enfin enlacer son père dans une insoutenable scène qui enserre le cœur à le faire péricliter. A travers Tótem, c’est notre propre rapport à la mort que soulève Avilés, cette mort qui domine nos angoisses et nos cauchemars, nous plombe par notre éducation religieuse tellement constrictive, alors que la mort est ce qu’elle, ce qu’elle devrait toujours être, un moment de souvenir, de transmission, une étape décisive vers l’immortalité, la spirituelle et non la chrétienne, cette immortalité de l’âme qui navigue au plus profond de notre humanité. Il n’y a pas de place au drame, pas de place au spectacle mortuaire, au grand discours pompeux, il n’y a pas de place à l’égoïsme du chagrin, à la souffrance comme mode d’emploi. Mais tout à la communauté, à l’élévation jointe de l’âme (cette très belle scène de la montgolfière qui monte puis s’immole).
Par la mort, Alvilés filme la vie, par la disparition, une humanité rayonnante, notre cœur enserré se libérant alors dans une profonde introspection sur le sens à donner à la mort, et par sa beauté, nous invectivant à la reconsidérer.