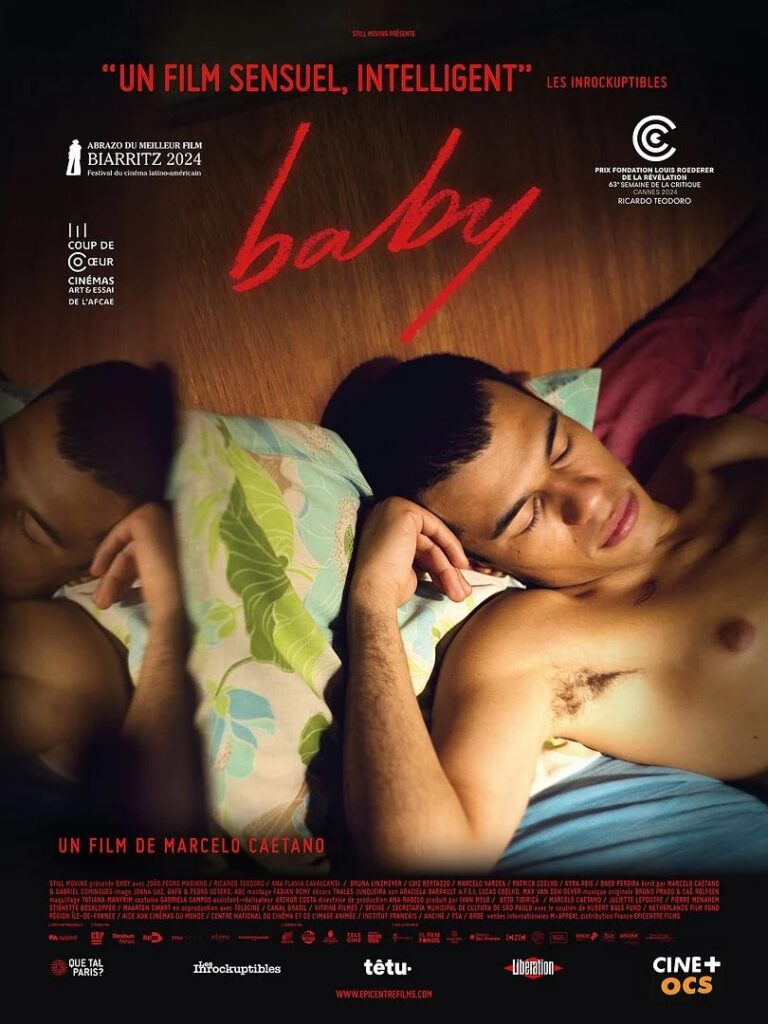La critique est à retrouver dans son intégralité dans le dernier numéro de Ciné-Feuilles.
Ovni cinématographique brouillant les genres, de Welles à Murnau, du film au noir au thriller fantastique, « La théorie du tout » fascine dès son ouverture grandiloquente, jouant de la théâtralité de sa bande-son pour détourner notre regard de son enjeu primordial, cet amour immatériel et transdimentionnel entre Johannes, jeune thésard en passe de terminer son doctorat, et Karin, fantomatique et mystérieuse figure vaporeuse, oracle de l’étrange, semblant lire l’avenir avant qu’il ne se produise.
Ce qui frappe d’entrée, c’est la singularité inouïe de son atmosphère, l’ouverture semble presque spielbergienne, hollywoodienne tant cette caméra qui envahit l’espace dramatise l’enjeu, puis apparaît ce noir et blanc très théorique nous renvoyant au cinéma allemand de Fritz Lang jusqu’à ce que jaillisse les codes policiers d’un film noir d’époque. Mais Timm Kröger (dont c’est le second long-métrage après « The trouble with being born ») va bien plus loin, il part habilement d’un cadre scientifique masculin et théseux (un congrès de physique dans les Alpes suisses) pour faire y faire éclater l’hérétique, le surnaturel de son cadre : des nuages menaçant et chargés d’électricité dans le ciel, un bruit de métal étrange sous la roches, un ascenseur prenant la forme d’une capsule temporelle. Le film prend alors une toute autre ampleur. Ce réel « cartésien » qui guidait les pas du jeune scientifique Johannes se délie sous sa mine blafarde (un vrai air de Ian Curtis chez son acteur Jan Bülow), la théorie controversée de son mémoire (sur l’existence des mondes parallèles) vient pas à pas se matérialiser, l’irrationnel se déclare, l’inexplicable amarrant le réel jusqu’à cette frontière de la conscience où les rêves prennent la forme de cauchemars (l’étrangeté des meurtres, la réapparition d’un mort,…).
Et puis Karin, personnage insaisissable, fantomatique, qui dès la première scène décide de fuir troublée par ce qui ressemble à des retrouvailles avec un Johannes qui pourtant ne semble l’avoir jamais vu ; elle est l’élément central qui équilibre la lourdeur physicienne de ce « multiverse », un éclat d’amour et de désir furtif, une émotivité immatérielle, elle semble tout connaître de Johannes, ses rêves, son passé le plus intime, mais aussi son futur et sa destinée. Il y a cette très belle scène de baiser, où l’on comprend que malgré l’apparence d’une première rencontre, ils semblent s’être toujours aimés, comme une évidence, un amour qui a toujours été. Cette courte interlude en apesanteur est de nouveau coupé par la fuite de Karin, faisant retomber le film dans une forme de thriller policier plus convenue.
Enfin, lorsque l’intrigue prend corps, que le tunnel entre les mondes se forme sous la montagne, Kröger pousse un peu plus le curseur avec un formidable jeu visuel et auditif expérimental, kubrickien, un magnétisme, une pression électrique qui implose à l’image jusqu’à sa destination stellaire, et avec elle, la mise à mort de son héros, là encore en grande référence au film noir et ses trahisons. Les morts s’inversent, les destins se croisent, les prémonitions sont déjouées. Et Johannes accepte son terrible destin de génie incompris, seul chez sa mère à chercher éperdument et jusqu’à la fin de sa vie, un fantôme, son fantôme, Karin, par un signe, quelques notes de piano, une apparition soudaine dans le clair obscur en preuve définitive de la véracité de sa théorie, et d’un amour qui ne cessera jamais d’exister.