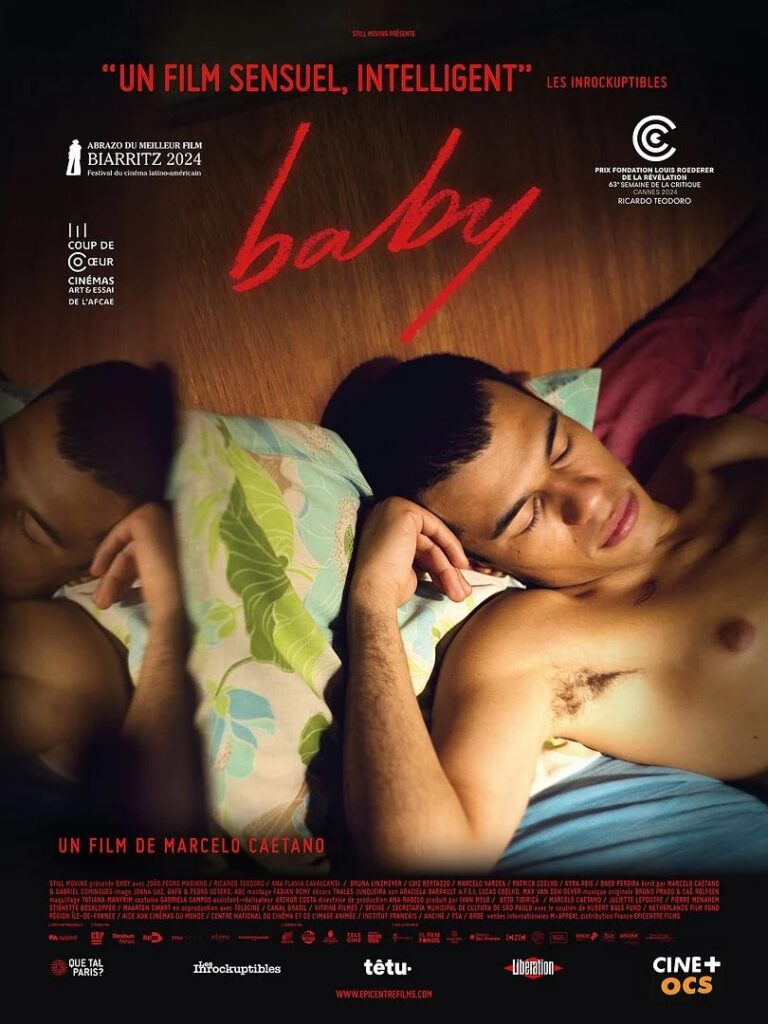L’année s’achève, et comme par magie, l’automatisme de ses conneries avec, sa ribambelle de musiques trop aigues, de rires trop joyeux, d’enfants qui hurlent et de mauvais téléfilms. Mais dehors, la terre gronde, les nuits sombres s’éclairent au feu de bagnoles, les lumières s’éclatent à coup de pelle et le jaune fluo a remplacé le rouge vif du souvenir enfantin. Le mot révolution, tant fantasmé par le démago anarchico-bobo, pétant en douceur dans son canapé de velours Fleux, le champagne qui goutte dans un foie-gras vegan trop salé (et ce con de frère qui parle de sur-assaisonnement en s’excitant de la prochaine saison Top Chef), n’est plus un concept utopiste de bibliothécaire. Comme le terrorisme marqua Paris en imposant la terreur et la guerre à nos portes cloisonnées en 2017, 2018 impose la détresse, la pauvreté qui s’insurge et la guerre contre un inégalitarisme insupportable. L’espoir est mort, l’odeur du pneu qui brûle remplace celle des ces marrons chauds toujours trop froids qui dégoutent, ce bonnet ridicule qui clignote à tout-va du collègue persuadé d’être drôle et décalé est enterré sous les décombres d’une Histoire violentée.
Le cinéma se nourrit du monde, impose en témoin libertaire sa propre vision du passé et du présent. Mais très souvent, par sa force avant-gardiste, il peut prédire le futur. En parlant par exemple du passé comme l’un des plus beaux films de l’année, Letode Serebrennikov. L’anarchie par la musique, cette volonté punk de tout foutre en l’air, même son propre futur, pour enfin accepter de vivre. Aimer, sous toutes ses formes, même les plus cruelles, briser les conventions hétéronormées qui implantent la peur de la différence dès la plus petite enfance (Girlde Lukas Dhont). Et bien sûr se battre. Par tous les moyens. En guerre de Brizé scelle le sort d’une entreprise à l’agonie, détruite par la mondialisation, pour qui ses salariés se battent à, littéralement, en crever. Rarement fut un moment d’une telle force et intensité au cinéma cette année. L’opposition entre le pauvre et le riche, la ville et la campagne, le monde évolué et la vie terreuse aux mains rocailleuses : Burning, absolu chef-d’œuvre de Lee Chang-Dong nous raconte comment le diktat sociétal de la notion de réussite entraine peur et jalousie, perdition de l’âme dans une quête malsaine de reconnaissance. Etre reconnu, c’est tout le désir pervers et narcissique de Lars Von trier qui livre avec The house that Jack buildle film le plus égocentré de ses vingt dernières année. Mais quelle réussite, si l’on délaisse la violence inouïe et presque comique de la première partie, l’introspection psychiatrique de sa propre démence est superbe. Clin d’œil psy au Paranoïa de Soderbergh, petite composition sur Iphone et miroir cruel d’une société de l’écran qui ne cesse de créer du fantasme : le cul siliconné, les pieds dans une mer turquoise, la bouche botoxé avalant une tarte meringuée revisitée, l’instagramisation, faire fantasmer sa vie pour mieux combler le vide sidéral de son propre ennui. Le livre d’image de Jean-Luc Godard, passé inaperçu mais toujours aussi juste, nous renvoie à la pauvreté d’une Europe qui meurt dans l’ennui et le mutisme. Tout le contraire de la grandiloquence à vomir et le commerce de la larme de Capharnaüm de Labaki. Des hurlements, un nourrisson enquillé d’un boulet au pied, du cinéma tragique au pathétique, qui nous rappelle que la sincérité ne se prétend pas, elle se filme.
2018 s’achève dans un torrent de violence et d’incertitude. Le cinéma n’a cessé de le dessiner, de nous alerter face à la noirceur d’un monde qui perd le contrôle de sa propre perdition. Tout va trop vite. Et ce que l’on peut simplement espérer, c’est que le cinéma de 2019 nous prédise un espoir nouveau. Peace.