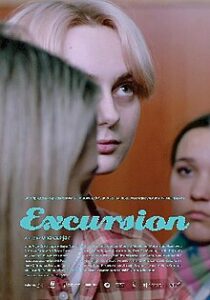MARS
Lorsqu’enfin la pudeur s’impose devant le scandale médiatique, que le combat de vies balafrées s’exporte à l’écran en dictant sa liberté face à une justice bienveillante (Grâce à Dieu de F. Ozon, finalement sortie en salle le mois dernier), il n’est pas l’heure de s’arrêter. Dans un combat devenu hebdomadaire, les cris deviennent moins audibles, le combat peut sembler s’essouffler dans un célèbre vent de l’épuisement médiatique dompté par les audiences de chaines d’informations. Et pourtant, l’air révolutionnaire français n’a jamais été aussi pur. Et au-delà de la bataille politique des Gilets jaunes, c’est bien le combat identitaire d’une liberté de penser qui est en jeu (lire l’appel à l’indépendance des Cahiers du cinéma). Cette liberté d’être et de décider sans se faire juger par la bien-pensance haineuse (LOL) et la perversité archaïques des extrêmes. Imposer sa personnalité interne, savoir dire non, et ne laisser aucune perméabilité à la connerie et la violence idéologique nauséabonde.
Entre Boy Erased de J. Edgertonet le Dumbo de Tim Burton (les deux films en salle le 27 mars), c’est le désir commun d’identité qui se dessine à travers pour l’un le combat d’une orientation sexuelle, pour l’autre le droit à la vie et à la liberté. Les grandes oreilles de Dumbo risées du peuple, métaphoriquement transforméds en ailes expiatoires. Jared et ses 19 ans, face à une thérapie de reconversion pour soigner son homosexualité fantasmée comme pathologique dans la campagne américaine. Une histoire vraie, baignée dans une actualité tout aussi flippante lorsque l’on lit les déclarations du psychopathe Bolsonaro au Brésil. Rien n’est aujourd’hui plus impossible, les combats du passé ressurgissent, ce que l’on pensait acquis remis en cause. Et c’est aussi le propos de L’arche russe de S. Sokurov(sortie également le 27 mars), voyage temporel à travers l’histoire de la Russie du XVIIIème siècle à nos jours, faisant ainsi un parallélisme terrifiant entre les complaintes sociales d’une époque que l’on penserait rétrograde au régime poutinien de la peur aujourd’hui. Tout se dessine alors comme une ronde circulaire ininterrompue où erreurs et révolutions se répètent sans cesse au cours de notre Histoire.
Dans un tel contexte social, Xavier Dolan prend le contre-pied avec sa fable Ma vie avec John.F.Donovan (sortie le 13 mars), lui qui court toujours après l’amour de sa mère, ce qui d’ailleurs fait bien jouir de plaisir la trentenaire en perte de repère, décrit ici la correspondance écrite entre un enfant et une star de la télévision américaine. Ce qui n’est rien d’autre que l’expression générationnelle du penchant narcissique de cette icône pop ne parlant finalement que de lui, de son rêve d’enfant magnifié par la starification du système, lui qui se dit mal à l’aise sur les plateaux télés en posant naturellement avec des sacs Vuitton. En parlant de Xavier Dolan, et de ses premiers pas hollywoodiens, comment ne pas voir l’escroquerie d’un talent indéniable devenue cliché de lui-même, lui qui se battait pour une cause noble (encore cette question d’identité soulevée plus haut) mais qui devient ici l’apogée de ce qu’il a probablement toujours voulu éviter.
Entre narcissisme, combat identitaire et vent historique, en mars, on cogite en salle. Et on évite de s’abrutir (au hasard, Captain Marvel).
AVRIL
Etre fier de son pays n’est pas un acte nationaliste, targué généralement d’extrémisme par les plus extrêmes, c’est d’abord un acte de foi raisonné en l’histoire de son peuple, une marque immense de respect aux combattants de la liberté du passé, et un geste émancipateur par le langage : dans un tel contexte de méfiance totale en l’élite et la gouvernance, comment ne pas s’emballer pour le Synonymes de Nadav Lapid (en salle depuis le 27 mars), combat d’un jeune israélien quittant un pays paranoïaque pour la France, encore fantasmé comme terre libre. Et cette liberté morale et de conscience, Yoav veut la gagner par les mots et le dialogue, un joli pied de nez à la violence sociale contemporaine et sans frontière , incapable d’établir une discussion de fond, dans une supercherie de débat national.
Lorsque la jeunesse algérienne s’insurge dans les rues, et que le pouvoir en place vacille, il y a de quoi reprendre espoir en la force intangible du peuple face à l’élite sourde et aveugle. Maigre consolation face à la déconfiture locale, où la seule réponse à la détresse sociale semble n’être malheureusement que l’escalade de violence face à l’inertie du pouvoir. Avec un Edouard Bear bien palot, et qui continue de penser que porter un cuir en 2019 ca reste jeune (aïe, « il s’agirait de grandir », référence hazanavisienne), Michel Leclerc sort La Lutte des classes (en salle le 3 avril). Le parallèle serait hasardeux, mais il est drôle de voir se démener la bien-pensance boboïste (ici un couple moderne à la con avocat-musicien) et la conviction de la laïcité par l’école publique face au désir égocentrique de parents souhaitant le meilleur environnement scolaire pour son enfant, dans un désir mégalo de réussite sociale. Réussite sociale bien ternie lorsque ta femme se casse, te laissant agoniser en père solitaire, la barbe de trois jours devenant blanchâtres puis gris clochards. Et c’est la queue plus trop bandante entre les jambes, que tu rentres chez les parents, la mine défaite. Je parle bien-sûr du retour de Tanguy de Etienne Chatillez (sortie en salle le 10 avril). Et le trio Berger, Azema, Dussolier qui joue une comédie à la française efficace dans une crise de quarantenaire à la dérive, le feu éteint, en conquête des dernières braises.
Tout est cyclique, les vingtenaires s’habillent comme les racailles des années quatre-vingt-dix, les chaussettes blanches et les pulls Fila, le bob, les chaussures compensées, les t-shirts trop courts sur des copycat des Spice Girls qui peuplent les abords des lycées. Que c’est laid. Et forcément, la branchitude de Jonah Hillne pouvait passer à côté avec son Mid90s (sortie le 24 avril), revival de Tony Hawk et ses pixels Playstation en version live, les premières van’s trouées et cette juvénile impression d’être le king de la city, ridant sur les bancs publics d’Ille-et-vilaine, en recherche de sensation forte. La première gorgée de bière qui pique, et ce vent de liberté dans les cheveux gras, le logo Korn sur un Eastpack bosselé.Liberté en avril, celle de vivre par le langage, le combat, sa passion, libre aussi d’avoir peur avec le 10 avril, Simetierre de Kevin Kolsh et Dennis Widmyer
MAI
Notre-Dame flambe, et l’idiot que je suis imaginais alors un soutien sans faille, et un élan populaire dénué de polémiques. Quelle naïveté juvénile et acnéique. Les anti-curés se réjouissent, les moralistes s’étouffent des donations du Cac 40, et les complotistes imaginent un fantôme macronistedansant sur des ruines incandescentes. Rien ne vaut un drame national pour mieux contempler les dysfonctionnements moraux d’une société agonisante. Ou peut-être le cinéma qui le sait parfaitement mettre en image.
On pense directement aux frères Dardenne, et l’humilité d’un cinéma du réel à porteur de message fort. On se rappelle avec vigueur du superbe « Deux jours, une nuit » et de sa plongée dans la violence du marché du travail, on s’enthousiasme aujourd’hui du Jeune Ahmed (sortie le 22 mai, sélection officielle cannoise), croisade adolescente en Belgique. La dichotomie absurde de l’idéal religieux et son diktat de règles abusives, avec la prétendue liberté du sentimentalisme hormonal du collégien, cette guerre interne , ultra violente, au moment le plus fragile, à la genèse de sa personnalité. Just Charlie de Rabekah Fortune (sortie le 15 mai)aborde d’un autre regard un thème similaire, la crise identitaire. Un jeune footballeur, empoisonné par le désir égoïste d’un père invasif, voulant soigner son propre échec par la réussite de son fils, s’empêtre dans une vie qu’il n’a jamais voulu. On pense immédiatement au « Girl » de Lukas Dhont, et la cage que peut représenter un corps qui ne nous appartient plus, une peau, des poils, le dessin d’un visage qui n’est plus en adéquation avec l’essence même de son être. Déchirant moment de vérité, lorsqu’encore aujourd’hui, des transgenres se font agresser en bas de nos rues, dans la capitale prétendue égalitaire parisienne.
Au moment où Julian Assanges se fait choper à Londres après avoir bombardé la planète entière de ses vérités cachés (WikiLeaks), notre Macron national manigançait son leak à lui en laissant filtrer son discours pour mieux nous la fourrer. C’est un peu comme les cascades et les films costumés dans le cinéma français, il faut mieux le laisser aux anglo-saxons, carrément plus doués en la matière. Autre terrain qui leur est cher, les biopics. On se souvient encore avec douleur des deux « Yves Saint-Laurent », et avec plus de douceur de « Rhapsody » dernièrement. Et bien Dexter Fletcherremet le couvert avec Rocket-man (sortie le 29 mai, hors compétition à Cannes)et l’histoire rocambolesque d’une des dernières rock star encore en vie, Elton John. De la loose aux paillettes, c’est Taron Egerton (vu dans les « Kingsman ») qui enfile le juste-corps. Ca sonne déjà faux avec sa ribambelle de clichetons à Oscars, mais moi qui chiais sur « Le grand bain » avant de le voir, je retiens ma langue vipéreuse. Je ne dirais donc rien non plus du film de Nicolas Bedos (La belle époque, qui sortira en novembre). Et mon dieu que j’ai envi d’être injuste.
En plein festival de Cannes, le mois de mai est archi bandant. On compte bien entendu sur la sortie en parallèle de l’ouverture du festival de The dead don’t die de Jim Jarmush (sortie le 14 mai, sélection officielle)pour redécouvrir Jarmush dans un film de genre après les vampires de « Only loves left alive ». Et voir Iggy pop en zombie matraqué par Bill Murray, ça n’a pas de prix.
JUIN
Sortir la tête embuée du festival de Cannes, c’est revenir brutalement à une réalité que l’on avait presque oublié. Etre coupé du monde dans cette ellipse temporelle, toute épuisante qu’elle soit, est un bonheur incommensurable. Ne plus s’en faire d’une planète qui crève, des élections européennes qui annoncent une poussée de chiasse d’extrême-droite, des morts innocentes en Syrie, de Vincent Lambert toujours en vie ou de Mbappé qui taillade le PSG. S’isoler au fond de son siège rouge, laisser de longues heures son téléphone éteint, et s’en branler, juste un instant, du monde qui nous entoure. Et prendre d’un égoïsme massif le temps de vivre à travers des images, un écran et des lumières qui s’éteignent, vivre d’inconscience, et chialer comme un puceau frustré, se scandaliser comme un cheminot en lutte, et débattre de futilité presque gênante (Tarantino, Malick ou Almodovar ?). Le Festival de Cannes, il n’y a rien de plus égoïste d’aimer des films qui parle de notre monde, mais en y étant dramatiquement coupé : quoi de plus scandaleux que de siroter une coupe de champagne dans une villa imprenable, en parlant des banlieues des Misérablesde Ladj Ly ?
J’ai donc joué parmi les égoïstes cette année, et ce depuis maintenant 2014. Je me suis pavané dans ce plaisir cinéphile comme un tox’ en mal d’héro, à courir les séances, à chercher l’émotion rare, le film qui t’en foutera une belle, celui que tu pourras te vanter d’avoir vu. « Non, tu n’as quand même pas raté la Palme d’or ? ». Et si enculé, j’étais trop occupé à chercher le carton d’invitation et prendre un selfie avec Aya Nakamura. Cannes n’est finalement que le reflet d’un consumérisme moderne, en quête de l’absolu, du film qui tue. Mais une quête forcément vaine, car la consommation de masse annihile le plaisir simple, et l’émotion se meurt ainsi dans le sur-plus. Trois, quatre films par jour, la digestion est aussi rapide qu’un bucket KFC. Et pourtant, comme chaque année, quand la tempête s’estompe, que l’adrénaline chute, et que l’on retrouve son quotidien pas si chiant, les émotions surgissent comme un lendemain d’acide, en remontée violente. Une vie cachée de Terrence Malick est un chef d’œuvre dont il est encore difficile d’en tirer toute sa profondeur, la puissance du non, du refus de collaborer avec l’ignorance et l’horreur, l’amour qui accompagne mais qui ne dénature par la puissance de la conviction. J’ai perdu mon corps de Jeremy Clapin, film d’animation à petit budget mais énorme cœur, qui nous bouleverse à travers une main baladeuse qui recherche son jeune propriétaire, paumé par une vie qui l’a giflé. Lux Aeternade Gaspard Noé qui nous traumatisme, Jeanne de Brunot Dumontet la voix de Christophe qui continue de nous envouter, Chambre 212 de Christophe Honoré qui nous rappelle que notre conscience n’est pas à vendre et Le jeune Ahmed des frères Dardenne, pour enfin nous faire poser les bonnes questions sur la radicalisation religieuse. Cannes est à vivre, Cannes est à dévorer, à vomir, à régurgiter, à avaler sans respirer. Cannes c’est le cinéma, le monde, avec sa part de lumière et sa grosse obsession du noir. Et le pire, c’est que rien ne nous fera l’abandonner. Chaque année, on s’imagine déjà le suivant.
Mais putain, moi je n’ai pas d’accréditation bâtard, qu’est-ce que j’en ai à foutre de ton festival de troufion en mal de confiance en soi ? Tu as raison de poser la question Jean-Michel. C’est pas le tout mais on a une élection politique qui arrive, et il faut bien prendre conscience des dangers des anti-européens qui…Allume CNews, et écoute le sexisme du fion Pascal Praud qui coule tout ce qui touche (en premier lieu son club du FC Nantes il y a des lustres) si ça t’intéresse, mais pas ici, pas maintenant Zinedine. Ici, je parle de cinéma. Alors on s’extase du Parasite de Bong Joon-Ho (sortie le 5 juin) qui retourne la Croisette (encore ? pardon, je m’en sors pas) avec un film de genre lui même retourné en critique sociale en opposant les pourris de riches et les gentils pauvres. On ne peut pas s’empêcher de parler de Bertrand Bonello avec son Zombi Child (sortie le 12 juin, vu à la quinzaine des réalisateurs…Ok, je sors) et son trip de morts-vivants façon intello sauce lait de coco. Tous les films sont à Cannes man, comment je m’en sors ? Et bien on peut se lancer sur Alma Jodorowski qui joue la Daft Punk-ette dans Choc du futur de Marc Collin (sortie le 19 juin, qui n’était PAS à Cannes) et les prémisses de l’électro girly du début des années 80. Putain, je commence à parler comme Pascal Praud, les boules. Et on va se finir ce mois de juin en beauté, avec un Toy Story 4 (sortie le 26 juin, PAS à Cannes) de feu, version Pinocchio et le jouet de gamin qui veut devenir adulte, mais un vrai, avec une queue pour bander et procréer. Pardon, je suis en roue libre, « mais c’est Cannes, tu comprends ? »