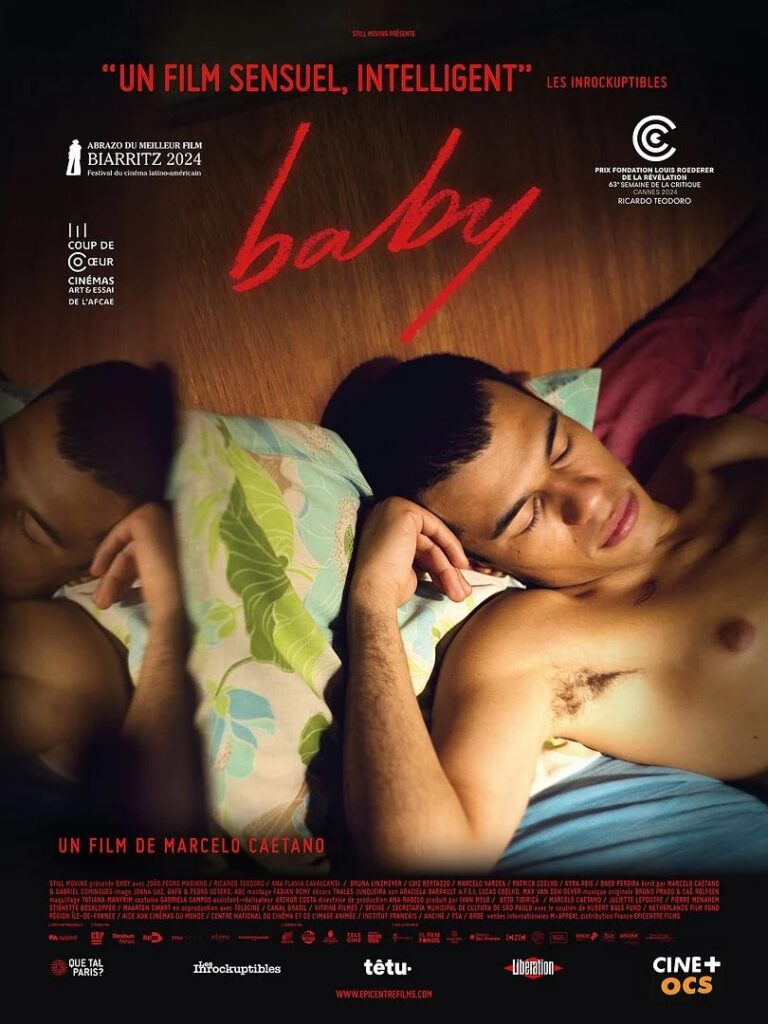La jaunisse infantile
Pour sa première montée des marches (au passage bien tardive au vu de sa filmographie, « La famille Tenenbaum » en tête de liste), Wes Anderson affronte les regards accusateurs de critiques aux aguets autour de sa coupe de cheveux moyenâgeuse. Quand est-ce que son cadrage minutieux, sa photographie lubique et son attrait exclusif aux pulls tricotés finiront par hanter son cinéma et le transformer en son propre cliché ? Moonrise Kingdomsigne incontestablement la fin d’un cycle – ouf ! – il n’est pas encore trop tard.
N’est pas « l’homme en noir » qui veut, je n’ai jamais été un bon pitcheur, alors résumons rapidement ce beau présent au ruban d’argent, bourré d’un certes futile polystyrène épais mais cachant un minuscule diamant, le diamant d’un tourne-disque chantant l’amour de deux enfants, Suzy et Sam, à peine douze ans et déjà la crise d’adolescence dans les jumelles : la découverte du corps, la fugue, l’inconscience, la violence. S’en suit alors une mission de recherche des deux fuyards dans une ambiance scoute à bermuda et tempête du siècle.
Oui, tout y est magique, féerique, le balayage-cadrage comme signature au même rang que le 360° de Michael Bay est d’une classe ultime. Mais cette photo jaunâtre nous rappelle trop d’heureux souvenirs, le personnage de Bill Murray est toujours ce vieux dépressif au charme oedipien, Kara Hayward est encore filmée comme un Godard amoureux de Karina, et cette manie d’habiller son film d’une bande son aussi pointue de bon goût (Françoise Hardy en vinyle) nous rend nostalgique d’un Seu Jorge dans La vie aquatique.Tout est sucré sans jamais être mielleux, rien est périmé, mais comme une bonne dose de moules au curry, à la fin, ça colle aux mains.
Une petite heure après Moonrise Kingdom, je me retrouve enchaîné De rouille et d’osdans la salle juxtaposée. Il m’était fort compliqué de trouver un véritable lien entre ces deux films à l’apparence diamétralement opposés. Mais au final, il en ressort une telle perfection, une recherche insensée du bon plan, de la larme qui glisse et de la blague qui siffle que l’ensemble bulleux devient intouchable, inaudible sous une cloche à fromage froide et impénétrable. D’un côté chez Audiard, la dramaturgie et l’indécence de vouloir trop en montrer, de l’autre chez Anderson, la beauté explicite et redite vient inhiber toute émotion véritable, ça caille un peu malgré une maîtrise artistique incontestable.
Evidemment, Bruce Willis et son pince sans rire ironique, la naïveté retrouvée de Edward Norton, la bouille intello-orpheline qu’un Pixar saurait esquisser (Jared Gilman), la beauté nordique foudroyante de cette Suzy en « fillette fatale » dessinent un casting – encore une fois – presque trop réfléchi. Moonrise Kingdomn’a remporté aucun prix à Cannes, sa seule présence est déjà une belle récompense pour un réalisateur que j’affectionne depuis ma tendre adolescence avec cette pensée qui me torture à chacun de ses films, « putain j’aurai aimé le réaliser ». Et je crois que sa sélection n’est pas anodine, elle vient, je l’espère, clôturer une aventure débutée il y a 16 ans avec son pote de fac Owen Wilson dans Bottle Rocket, conclure un cycle disons jaunissant pour ouvrir des nouvelles perspectives à ce maniaque hystérique, à cet amoureux éperdu de la France et de l’élégance, à ce « vieuj’ » (traduire jeune-vieux) familier du tweed.
Mûrir, grandir entre la butte Montmartre et les bas quartiers de Brooklyn et un jour, revenir en terre cannoise fringuant et palmé. Mais contrairement à Terrence Malick façonnant son Tree of Life à l’image de Gilles Jacob, ça ne peut être la réalisation ultime d’Anderson. Il n’en reste pas moins que son style bien qu’idyllique va devoir évoluer en une noirceur de l’âme plus prononcée (avis personnel). Quoi qu’il en soit, l’avenir nous le dira ; ce qui est sur c’est que le futur lui appartient déjà.