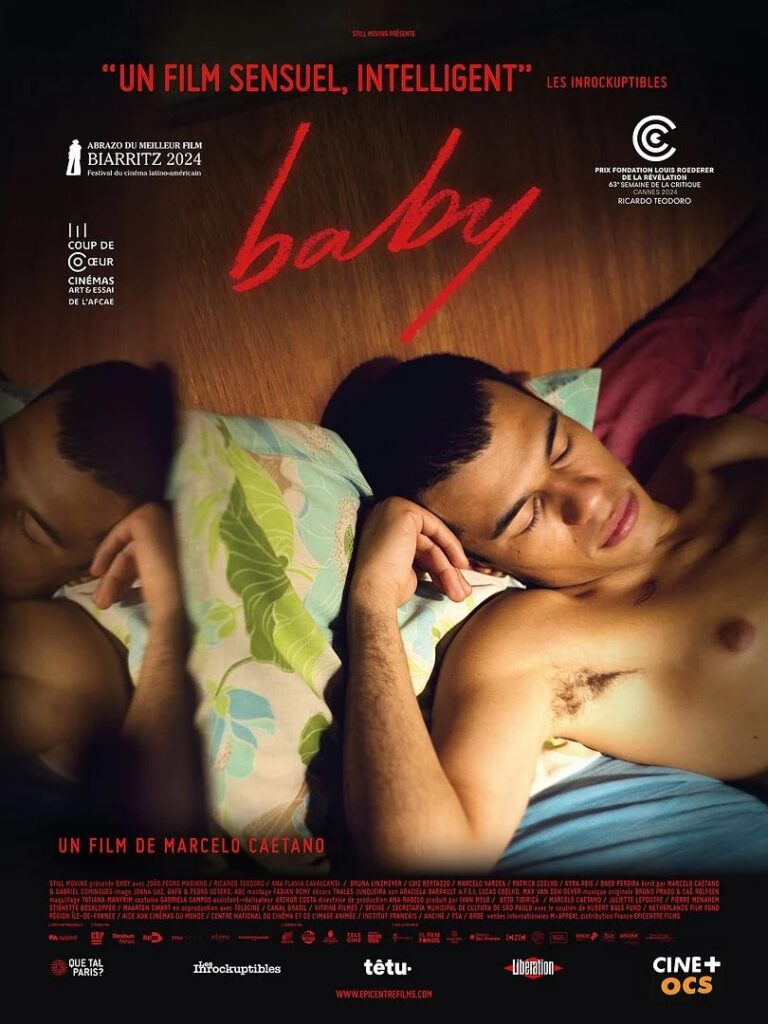La critique est à retrouver dans Culturopoing
Il y a chez Miguel Gomes une façade abrutissante par la démonstration, le fameux tour de force esthétique qui a pu prévaloir sur sa propre identité de cinéaste, perdu dans un élan colonialiste nauséeux (dans Tabou), ou dans une lecture politico-économique bien maigrelette (dans sa trilogie Les mille et une nuits). Avec Grand Tour, il réussit à éteindre un orgueil déplacé pour s’élever au rythme de l’absence à la plus pure des valeurs morales, celles d’un égo en berne, là où l’individualisme peut faire définitivement place au collectivisme, et que son cinéma biberonné à la grandeur puisse enfin trouver sa mesure à travers le voyage d’un autre possible, d’un « au-delà » brisant les frontières cadenassées. Avec Grand Tour, Gomes filme une magistrale réincarnation (dans le sens, un « retour à la vie ») en croisant la destinée de ces personnages (Edward et Molly) dans un désapprentissage salvateur.
L’absence est bien la maîtresse du rythme de ce Grand Tour, là où le temps n’est plus (anachronisme de chaque instant, l’histoire contée est datée de 1918, lorsque les images figuratives sont contemporaines), le langage par sa mixité en devient une inaudible tour de Babel redéfinissant le mot en brouhaha, les personnages, spectres d’un temps oublié, tous deux vêtus d’un blanc fantomatique, et n’apparaissant jamais à l’écran lorsque la voix off en narre leurs actions. Il n’y a pas de mielleux jeu de piste, mais un abandon, celui de laisser cours à l’inaction, et à sa vertu, l’imagination. Tout semble d’une fluidité aqueuse, au gré des vents et des traversées maritimes, Edward fuit sa mariée, sans but apparent, si ce n’est celui du refus d’exister par l’individualisme de cet amour, briser les chaînes de cette prison maritale qui lui est insupportable. Et donc, désapprendre, « se libérer de ses convictions » (citation littérale du film, et ce très beau gros plan bressonien sur l’œil perçant d’un âne). Quoi de mieux que l’immersion dans « l’ailleurs » pour renverser ses paradigmes sociaux et moraux, ne pas parler, mais observer, se nourrir de la différence dans la plus prestigieuse des attitudes, le silence, la quiétude et l’apprentissage de l’autre, des mœurs et coutumes de Bangkok à Singapour, du Japon à la Chine voisine. Là où Gomes pouvait être taxé de colon en repentance, il prend ici une toute autre dimension par la distance et non l’invasion, la considération et non la sur-interprétation, la médecine, le commerce, la spiritualité, tout un monde se redéfinissant sous les yeux d’un Edward qui ne cherche ni à grimer ni à comprendre, mais à s’absorber de la différence. A mi-film, il s’abandonnera définitivement au terreau de sa différence, allongé, les yeux clos dans une ataraxie élévatrice, au son d’une mélodie titrée Passion sans fin.
Face à lui, le chemin est inverse, mais la destinée commune. Molly, persuadée que l’amour de sa vie s’est évaporée pour une raison cartésienne (le travail ?) va alors à son tour, et à rebours (magnifique passage d’un radeau en contre-sens, le courant l’immobilisant), prendre la voie du Grand Tour. Des télégrammes les lient, tenace comme personne, elle tente de deviner le trajet de son bien aimé. Mais à son tour, elle y trouvera bien autre chose. Son rire pincé entre ses lèvres joueuses, désamorce la dramaturgie, son visage espiègle et d’une beauté naïve nous emportent : croire sans y croire, espérer sans espoir. Et puis, le lâcher prise, refuser de voir la vérité (son amour est désormais perdu) c’est aussi en bâtir une nouvelle, de vérité. Celle d’un nouveau champ du possible : et pourquoi pas un autre amour (avec ce richissime américain éleveur de bétail) ? Et pourquoi pas de nouveaux amours ? « Pourquoi n’aimerais-je qu’un seul homme ? » s’interroge une amie, et servante du nouveau prétendant de Molly. De nouveau, la rancœur de l’individualisme amoureux s’effondre face au torrent du pluralisme et de l’amour multiple, la multiplicité des plaisirs, et le dépassement de l’égo d’un mariage fichu. Sa rencontre avec un prêtre sur un radeau de fortune, sans qu’elle en ait encore conscience, bouleversera sa pensée. Ce prêtre qui a décidé de tout quitter pour rentrer en Angleterre, abandonnant alors sa foi et ses convictions propres. Molly l’interpelle en lui signifiant la tristesse d’une telle décision, il lui répond que c’est une libération. La mort suivra cette révélation dans une forme de repentance décisive. Et tout comme Edward qui a quitté l’écran depuis longtemps, la fin de Molly est proche, allongée au fond d’une forêt, la fumée de l’opium l’enveloppant. Son élévation est alors bien plus christique que celle d’Edward, son visage, une fois décédée, va alors s’illuminer. Mais pas par n’importe qui/quoi, illuminé par les feux d’un projecteur de cinéma, comme si Gomes nous confiait avec malice la capacité régénératrice, voire curatrice, de l’image, capable de sauver les morts de la fatalité. Car de cette mort naîtra la renaissance, une vie nouvelle désamorcée du poids des conventions, où seul importe la libération de l’égo, la destitution des normes, et la jouissance libre, une nouvelle vie non plus de fuite, mais de quiétude.
Par l’absence du tout, Gomes filme magistralement la libération des croyances, le désapprentissage de l’amour individuel, ce détachement du carcan occidental par l’observation et l’écoute, la défection de l’égoïsme pour l’amour du pluralisme. Ainsi bâti, Gomes fera alors rayonner à sa toute fin le visage éclairé de la réincarnation.