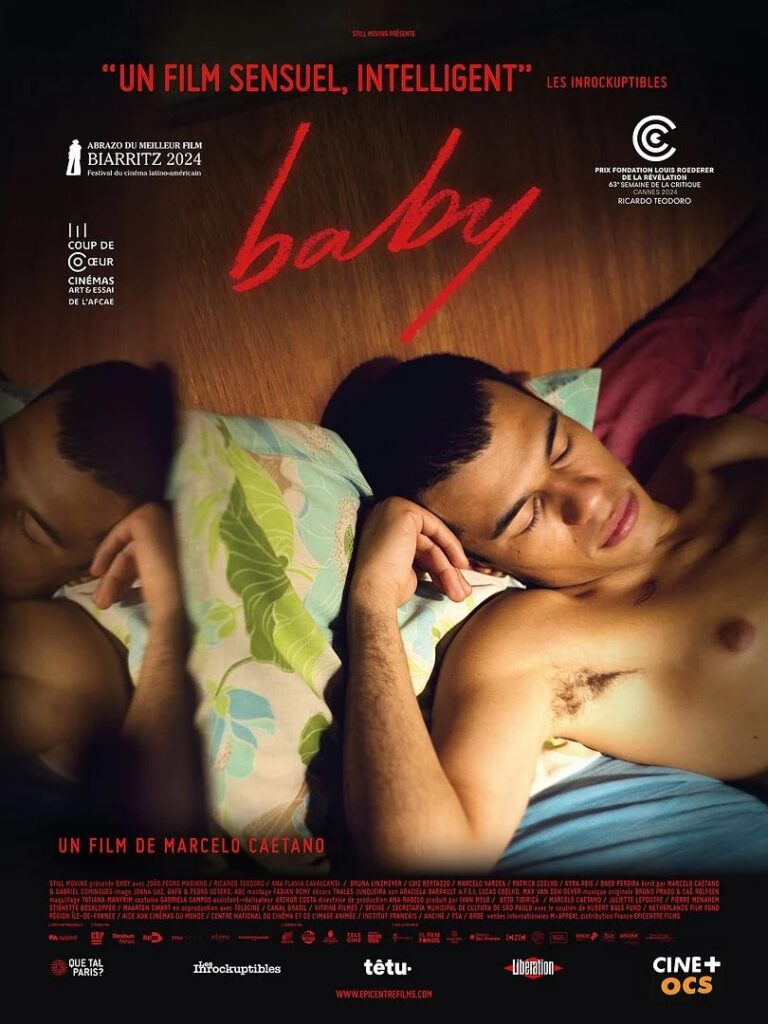Été 2019
C’est l’été, ça dégouline, le doigt qui se glisse dans une aisselle trempée, l’odeur marine d’un slip trop serré, les corps qui se dénudent dans une pudeur volatilisée par l’UV. Il fait chaud, affalé dans un canapé-lit qui te déglingue un dos fragilisé par une sédentarité à faire pâlir le tétra voisin de palier et son fauteuil qui grince, mais qui berce avec volupté ta sieste dominicale. Ta télé est allumée, hypnotisée par les routes escarpées du Tour de France et l’odeur du goudron brûlée, tes yeux vacillent, et t’abandonnent dans une rêverie félinienne. Des formes géométriques disproportionnées et ces premières paires de seins caressées, les couleurs stroboscopiques d’un cinéma en plein air, la rotation ininterrompue d’une langue abrasive dans une bouche baveuse et ton nez qui respire pour la toute première fois l’odeur du foutre tiédie par l’effet de serre d’une tente de bord de mer. Retour à la réalité, il est 17 heures, et ton dimanche est déjà bien niqué. Ta meuf te tanne pour bouger au château de Chantilly ou à la ferme bio du Plessy, mais quel merdier. Alors tu te dis que t’abrutires devant Netflix et son portfolio d’idiocrate sans cravates t’élèvera un peu ton esprit vaporeux. Et tu te persuades que Black Mirror est toujours à la hauteur, que Dark c’est du Orwells contemporain et que le documentaire sur l’intelligence artificielle répond avec brio au 20 ans de Matrix. Et bien, tu te trompes. Et le misérabilisme de ta petite vie hideuse ne s’en sortira pas tant que ton cul sera scotché à ce canapé-lit, que les roues de ton voisin continueront de grincer, et ton abonnement Netflix te sucer.
Quand j’apprends avec un dégout certain que Netflix tente de s’accaparer les droits du fabuleux « J’ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin, film d’animation grandiose et révélation du dernier festival de Cannes, comment peux-t-on s’empêcher d’hurler une colère qui n’a finalement aucun poids dans ce désert aride consumériste. Privé les salles de cinéma de recevoir du cinéma, quelle drôle d’invention moderne. Prenez Kev Adams et Danny Boon, capturez Antoniente et Dubosc, mais laissez le cinéma indépendant tranquille. Par pitié, même l’extraordinaire Paul Thomas Anderson s’est fait enculer par le N rouge et noir. Et quand Refn s’extasie du streaming, on ne peut que se raccrocher au vieux loup de mer Tarantino qui rêve d’un cinéma unique en 8mm. Ne faut-il pas alors baisser les armes ? S’effondrer dans ce vieux canapé-lit, et ne plus bouger. Avaler de l’image, suer sans dégouliner sur son voisin, péter avec lourdeur sans tenter le discrétion du silencieux, bouffer son BK Delivroue et jouir d’un plaisir solitaire, égoïste où le seul partage restera un screen-shot du dernier plan pour ta storie Instachiasse ?
C’est l’été, et la canicule qui délivrera peut-être ta grand-mère t’oblige à t’isoler. Pourquoi ne pas choisir Danny Boyle et « Yesterday » (sortie le 3 juillet) aka « best pitch ever ». Tu te réveilles, et il n’y a que toi qui connaisses les Beatles. Du coup, tu pompes toutes leurs zikes et tu deviens une méga-star. Trip mégalomaniaque de sieste d’été, assurément. Le nouveau film de Luc Besson ? Non je déconne, t’inflige pas ça (« Anna », sortie le 10 juillet), écouter Jean Reno jouant la voix de Mufasa dans le Roi Lion version Favreau (sortie le 17 juillet) ? Mais pourquoi pas. Sinon, cours voir le dernier Tarantino « Once uppon in Hollywood » (sortie le 14 août) et Zahia dans le film de Zlotowski « Une fille facile », un revival des « Valseuses » magistralement mis en scène. Ou pas. Mais alors par pitié, va prendre une douche.
Septembre 2019
La rentrée de septembre offre toujours cette étrange sensation d’un été toujours trop court et jamais assez chaud, cette angoissante impression de n’avoir pu déconnecter d’un monde qui n’arrête jamais de se détraquer : son élite qui continue de partouzer notre planète comme un vulgaire vagin Epsteinien, en toute impunité et dans une inexorable descente aux fourneaux, les degrés qui s’emballent et la banquise qui se noie. La salle de cinéma semble donc l’isoloir parfait à la connerie humaine, quoi que souvent bien présente dans la salle (le bruxisme à pop-corn) ou à l’écran (le forcément raté « Ça » et son come-back le 11 septembre ou le pas moins lourdingue retour de Rambo le 25 septembre). Mais si se couper du monde le temps d’un film semble être le programme idéal d’une rentrée toujours difficile, il n’en reste pas moins obligatoire de se taper les concours d’UV à la machine à café, les histoires de cul type Cap d’Agde du collègue sans pudeur et le saroual de l’amie partie en Inde (« Non, mais ça a changé ma vision du monde, voire cette pauvreté en bas de mon palace colonial, ça m’a bouleversé») : le réveil sonne bien la rentrée des castes.
Mais pas que. La rentrée c’est aussi l’émoustillement d’un nouveau départ, de nouvelles rencontres. Et peut-être celle d’un amour éternel ou d’une rencontre éphémère. Le cinéma s’est attaqué à bien de ses versants. Ce mois-ci, Klapisch nous le raconte via le prisme malaisant des réseaux sociaux, heteronormé dans une relation de couple de parigos tinderisésà la con. Ça ne devrait pas voler très haut (Deux Moi, sortie le 11 septembre). C’est alors que je me rappelle avec bien plus de douceur d’un film à transgenre branché dans le milieu du voguing new-yorkais découvert à Cannes (ca claque des dents chez le bobo là) : Port Authority de Danielle Lessovitz (sortie le 25 septembre). Un jeune blanc-bec s’encanaille d’une renoi, tout les opposent blabla. Puis il tombe raide dingue de cette meuf, reine du voguing underground et entourée de son crew gay. Le mec commence à flipper car il traînasse avec une enflure de néo-nazi qui veut taper du PD. Puis il découvre que la meuf est un trans. Chamboulement ? Pas vraiment. C’est beau, c’est simple, ce n’est pas un grand film, mais il n’en reste pas moins nécessaire dans le contexte social de méfiance qui nous débecte. Liberté d’ailleurs, titre du dernier film d’Albert Serra, partouze de pérruqués 18ièmesiècle dans les bois de la forêt noire germanique (pas de jeux de mots, promis): festival de cul dans une liberté perverse de scato, sado et tout ce qui finit par O. D’une prétention démesurée, interminable malaise d’un huit-clos quasi-risible (sortie le 4 septembre). Si c’est ça le prix de la liberté, permettez moi de rester enfermer dans ma levrette hebdomadaire.
Allez courage, le mois de septembre c’est aussi le fabuleux Jeanne de Bruno Dumont (sortie le 11 septembre) et sa musique originale bouleversante de Christophe, les photos de vacances de maman toujours mal cadrées, les babouches en plastique ramenées par mamie de son voyage à Marrakech, la cartes postale des plus belles bites des sculptures italiennes de ton pire ami, qui suivra probablement du tablier de cuisine de la même veine, mais surtout la conviction que l’année prochaine, ca ne pourra pas être pire que ton AIRBNB chiotte sur le palier de cette année. Mais attention, l’être humain est plein de ressources inespérées et ne reculent devant rien : il est même capable de rire ouvertement d’une jeune adolescente porte-parole d’un monde qui se meurt, avec les yeux fermés et le cigare au bec ; caricatural, bien pire qu’un méchant de mauvais film d’espion car celui-ci est bien réel.
Octobre
Comment survivre dans ce merdier ? Est-ce que le nihilisme ne serait donc pas la transition la plus adaptée face à l’écologique qui semble perdue d’avance ? Peut-on encore consciemment pensé que l’idiocratisasion d’une société qui applaudie des sneakers exposées dans un centre d’art contemporain peut résolument prendre de bonnes décisions ? Peut-on, à trente ans, espérer quoi que ce soit d’un futur qui s’assombrit, et qui n’est désormais dessiné que par une médiocrité atmosphérique, entre les vingtenaires qui s’extasient des années 90, et les quarantenaires, d’un egoïsme invraisemblable qui délivrent des bambins à la pelle sans considérer le futur qu’ils leurs offrent. Peut-être que la redemption viendra donc des plus jeunes, ces collégiens qui gueulent, chaque vendredi, menées par l’héroïne des temps modernes Greta Thunberg. Eux qui, bien naivement, mais d’une force inédite semblent enfin vouloir bouger les lignes. Et pour le coup, leur prise de conscience est formidable. Qu’est ce qu’était l’écologie à mes 15 ans ? La question ne se posait même pas.
Quand Ken Loach s’attaque à l’uberisation de la société (Sorry we missed you, sortie le 23 octobre), il est déjà anachronique, la modernisation du travail et de la consommation a déjà dépassé le stade de l’esclavagisme moderne, il s’attaque désormais à l’abrutissement de masse par l’image et la domination par l’écoute (Allo ? Zuckerberg ?). Quand Mati Diop et son bel Atlantique (sortie le 2 octobre) filme avec brio un sujet similaire (des travailleurs sénégalais exploités par un magnat de l’immobilier, qui rêvent d’une vieille Europe qu’ils ne verront jamais, morts en mer, laissant leurs femmes, seules et sans un sou), elle voit la révolution par la zombification du peuple au sens littéral, non pas comme l’on pourrait l’imaginer en mouton de Panurge mais par une révolution féministe qui se soulève contre l’autorité capitaliste par l’investigation de la peur. Quand Todd Philips filme Joaquim Phoenix en Joker (sortie le 9 octobre), et transforme la folie en anarchie, il nous parle également de révolution. Plus métaphysique, mais dans une violence salvatrice comme chez Mati Diop. Comme si l’être exclu, les peuples isolés et le travailleur en bas de chaîne ne pouvaient s’émanciper qu’à travers l’investigation de la peur, de la menace, et d’une révolution personnelle ou commune qui s’entend, qui se hurle.
On peut certes continuer de s’apitoyer sur le versant pathétique que ce soit à des collégiens d’amorcer une telle révolution. Mais la précocité n’est plus à prouver, lorsque la première cigarette est à 10 ans, la première ligne a 13 et la première levrette à 14, que cette révolte vienne de nos neveux en devient presque logique. La première réaction facile est d’en rire, puis de s’en foutre. Mais tâchons, nous autres trentenaires looseurs, d’enfin réagir, soutenir le mouvement ou au pire, simplement le suivre. Ca fait 10 ans maintenant que l’on ne branle rien à amasser notre capitale misérable, et tenter de trouver un sens à notre vie entre cuite dévalorisante et borred-out, nous et notre génération paillasson qui n’a rien fait, et qui ose encore s’émouvoir de la suite de Shining (Doctor Sleep de Mike Flannagan, sortie le 30 octobre) ou se questionner sur l’amour et sa nostalgie à la con (Chambre 212 de Christophe Honoré, sortie le 9 octobre).
A nous de rejoindre nos nièces et neveux, et tenter de sauver ce que l’on peut. Au mieux un climat mourrant, au pire le peu de dignité qui nous subsiste.
Novembre 2019
Le Joker de Todd Philips a dépassé le million et demi d’entrée : comment d’un tel abattage médiatique et bain de pieds collectif à litanie de compliments sans retenue cette société de l’image arrive-t-elle a nous imposer à sa guise sa bien-pensance culturelle ?
Déjà vu avant de le voir, avec son matraquage d’image et d’esclaffements publiques, le Joker est le symbole de l’escroquerie artistique moderne, où les dires et le marketing deviennent plus importants que la qualité de l’œuvre. Car il est un film purement anodin, avec un Joaquin Phœnix hérissé en cache-misère d’une absence sidérante de réflexion socio-psychologique, et qui tire sur plus de deux heures une succession de sketch sans liant, pas même une esquisse d’analyse, de réponses aux interrogations soulevées, comme si le film dépassait son propre metteur en scène. Alors comment un tel film peut-il autant s’imposer à nous, rendant même son visionnage obligatoire tant il s’est imposé en sujet de société ? Ne pas le voir reviendrait à fauter, « être passé à côté ». Je crois que la thématique omniprésente de la détresse sociale, d’une forme de fraternité oubliée par la froideur néo-libérale est une partie de l’explication. Son sujet en pleine actualité, à défaut de réponses, nous offre à minima un début de questionnement. Car il nous renvoit aujourd’hui au Chili qui prend feu, au Liban qui porte son masque, au Venezuela en guerre civile : les démons du passé resurgissant, les militaires sont dans la rue, et la misère sociale bascule en détresse puis contestation, avant l’affrontement et les morts. La violence par le chaos est-elle l’unique solution d’une société qui collapse ? Tuer et détruire, ravager les espaces publics, accepter de mourir pour une cause plus grande que son soi, est-ce finalement là le dernier espoir de reconquête d’une certaine humanité mourante ?
On peut honnêtement le croire, mais l’Histoire nous prouve le contraire. car une révolution peut tout aussi naitre du courage d’un homme seul qui s’oppose par l’écriture à une autorité malade et dictatoriale de la pensée. C’est ce que nous raconte Roman Polanski avec sa lecture personnelle de l’affaire Dreyfus dans « J’accuse » (en salle le 13 novembre) à travers le personnage emblématique du Colonel Picquard. Ladj Ly et sa vision moderniste des « Misérables » (en salle le 20 novembre) repose cette question de la colère, de la violence face à la Loi, des flics au regards perdus, désabusés et mutés en cow-boy des cités. Comment réagir face à l’insoutenable injustice d’un Etat censé défendre ses citoyens, alors qu’il finit par les harceler et les matraquer ? La confrontation en devient cette fois-ci inévitable, tant tout paraît si éloigné de nos regards bourgeois et des considérations élitistes de nos politiques isolés du monde. « Les Misérables » n’est pas un film de banlieue, il est un grand film sociétal qui répond avec ardeur et intensité au démantèlement progressif d’une société qui s’isole et se communautarise.
Là aussi c’est l’histoire d’un jeune homme abandonné, fils d’immigré, orphelin, et laissé à la merci d’une famille qui ne l’aime pas. Face à lui, sa main qu’il s’est coupé et qui tente de le retrouver. « J’ai perdu mon corps » de Jeremy Clapin (sortie le 6 novembre) est un film d’animation bouleversant, qui arrive d’une élégance magistrale à jouer l’équilibre entre l’intensité d’action et l’émotion brute, on ne peut ‘s’arrêter d’écouler des larmes chaudes de détresse, puis d’espoir dans une vision humble mais si juste d’une vie injuste. Grandiose. Capital mois de novembre donc où les révolutions éclatent à travers le monde, et le cinéma tente d’en déjouer ses origines. Du cinéma à la rue, qu’un pas à franchir, qui peut être décisif.
Décembre 2019
Les 4 commandements
Crapuleuse parenthèse de décérébrés en quête d’imaginaire bisounours, Noël et sa farandoles d’absurdités débarquent dans un délire de paradis blanc à la Berger, sans prévenir, d’une surprise générale et totale (« Non mais attends, on est DEJA à Noël ? » dit-elle d’une voix irritante). On s’enivre dans des bouffes à rallonges où le foie d’un animal mort et l’iode d’un vivant enorgueilli nos désirs de sens, on se pavane dans des tricots immondes, le sourire forcé jusqu’à faire saigner nos lèvres gercées (« Qui a du Labelo ? » dit-il d’une voix zozotante), on s’extasie pour bébé, se désole devant les blagues de pépé, avant de prier qu’une fois pour toute, Netflix rachète Noel pour en faire une mini-série à bouffer en accéléré. Mais n’ayez crainte, j’ai la solution pour sauver votre âme enjoué de petite putain consumériste, « sale traîneau ». Mais il va falloir se sortir les moufles du fion, résister à la tentation obscure du pain surprise fromage frais, du fagot de haricot sauce gribiche et de la bûche café-calva. Voici donc les 4 commandements de décembre qui soulageront – un peu – la vue double-menton plongeant de ton miroir pourtant amincissant.
1. Tu n’iras pas voir le dernier Star Wars (« Star Wars, The Rise of Skywalker » de J.J.Abrams, sortie le 18 décembre)
Perpétuel copy-cat de l’ancienne trilogie avec ses deux premiers épisodes mimant la destruction de l’étoile noir dans le premier, puis l ‘anéantissement de la résistance dans le second, il faut donc s’attendre à des boules de poils à lance-pierres combattant la liberté des peuples. Ou une invention marketing dans le genre, avec Ray et son accent british en guise de sauveur de la galaxie, combattant le méchant Kylo Ren, lourdeau aux fantasmes incestueux avec sa lubie de papy. Et ce n’est que le début de l’indigestion, du Star Wars partout, tout le temps, à la télé, au ciné, dans ta tasse de café. Il est donc primordial de refuser l’engrenage, et stopper cette grande bouffe galactique, et juste profiter de l’Empire contre-attaque sous la couette d’un dimanche enneigé, chaque année.
2. Tu ne t’exciteras pas du noir et blanc plombant et intello du dernier Pattinson (The Lighthouse de Roberrt Eggers sortie le 18 décembre)
Mais quelle beauté esthétique, la photographie est saisissante, le réalisme terrifiant, Pattinson est vraiment un grand acteur. « Tu l’as vu ? ». Non. Typique du film que tout le monde encense mais que personne n’ira voir. Memorisez ma première ligne, balancez là entre la poire et le dessert, et épargnez vous cette escalade de lenteur. Cela aura pour effet de limiter la purulence de la bien-pensance cinématographique qui envahit jusqu’à nos voisins incultes.
3. Tu n’iras pas non plus voir le dernier Jumanji malgré le chantage de ta nièce qui te hurle dessus(Jumanji, next level de Jake Kasdan, sortie le 4 décembre)
Tu lui avais pourtant promis de l’amener. Elle était si heureuse de partager ce tendre moment avec toi le lendemain du déballage frénétique de ses jouets par milliers. Mais tu seras ferme, et l’éducation cinématographique doit commencer dès le plus jeune âge. Donc tu ne la laisseras pas s’abrutir devant la musculature saillante de The Rock et son faciès aux 3 expressions, tu lui expliqueras que ce film est une daube, et qu’il ne faut jamais aller voir de daubes. Tu l’installeras avec toi sur le canapé familial, en lui expliquant les références godariennes dans E.T. de Spielberg.
4. Tu chialeras devant Malick en te promettant de ne plus jamais me contredire qu’il est le plus grand(Une vie cachée de Terrence Malick, sortie le 11 décembre)
Indéniablement l’un des plus beaux films de l’année, Malick revient dans un scénario plus structuré à l’essence même de son cinéma transcendentaliste, virevoltant d’un génie sans commune mesure. Il aborde ici la force immuable de la conviction éthique face au sentimentalisme, de l’amour de la conscience avant celle de l’autre (notamment de sa femme). C’est un film magistral qui ne cesse à la fois d’émerveiller par sa mise en scène et la beauté du cadre (les alpages autrichiennes), mais aussi de remuer son fort intérieur d’un message fort et questionnant. C’est la BA de fin d’année, voir Une vie cachée, et en parler.