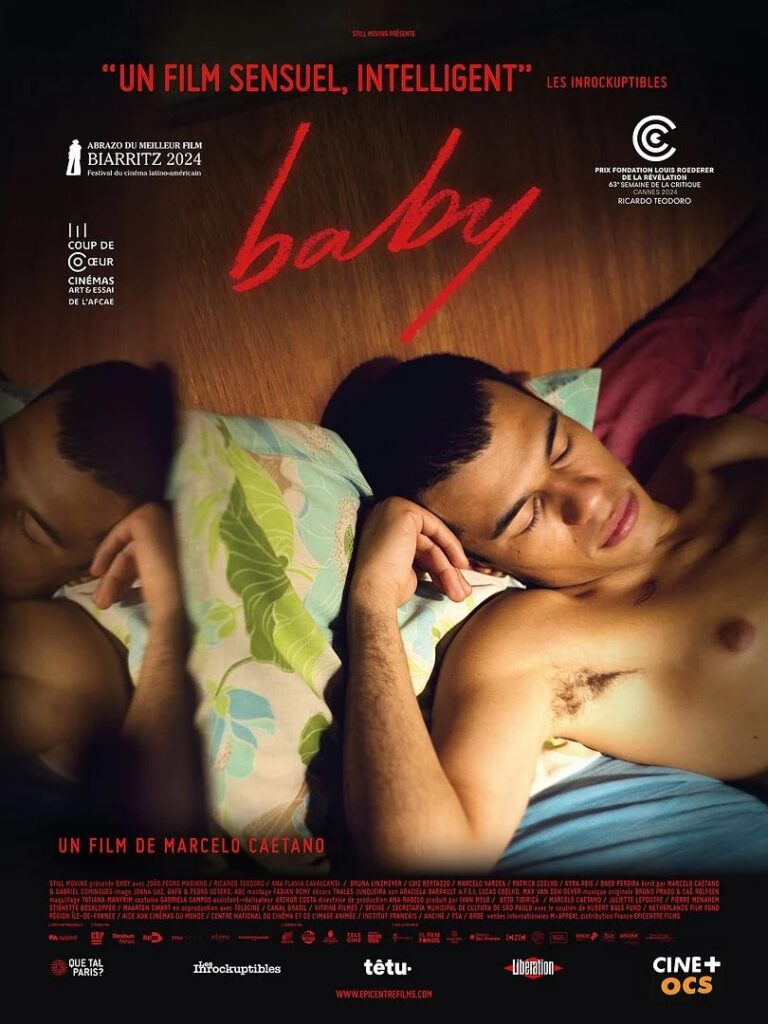Ah, cette bonne vieille cuite. L’alcool qui trône et impose son ambivalence manichéenne, cette naïve impression que la nuit tombée le monde nous appartient, pour une fois le soleil levé, ne plus jamais devoir le supporter. De l’amour et son lot d’aventures quand les mots sont plus faciles à sortir, de la violence et sa brutalité sombre quand l’amnésie gagne un cervelet éteint. Quoi de plus cinématographique que la cuite. Qu’elle soit en noir et blanc ou en couleur, en costume ou en training, d’une bière tiède ou d’un champagne millésimé, la cuite fascine, ascenseur émotionnel intemporel, lieu de culte qui n’a jamais lassé le cinéma, depuis le muet de Charlot et sa désintox (Charlot fait une cure, 1917) jusqu’à la récente nuit berlinoise de Victoria (2015).
Elle peut-être bonne-enfant, la tête qui tourniquotte un peu, le regard qui divague mais le chic ne jamais quitter celui qui la prend de plein fouet. Quelques exemples avec The Partyde Blake Edwards et la première cuite d’un Peter Sellers mué en indien maladroit. L’air hagard dans son pyjama une-pièce mais l’oeil encore assez vif pour ramener la belle Claudine Longet au petit matin. Ce petit matin filmé par Dino Risi dans Le Fanfaron où Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant se réveillent sur une plage toscane, la chemise blanche sortie du pantalon à pince, pour un concours de ping-pong sous le son de Pepino Di Capri. Ces cuites que l’on rêverait courageusement de vivre, comme les nuits folles de la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés dans les années cinquante, insultant la rive droite de « banlieusard » et picolant du whisky sec au « Bona » dans un monde qui déjà leur échappe (Les Tricheurs de Marcel Carné). Qui dit cuite en noir et blanc, costume et gouaille parisienne, comment ne pas citer Lautner et ses Tontons flingueurs, une gnôle polonaise arrache-viscère à faire suer Jean Lefebvre. Transformant la dépendance à l’héroïne du bouquin en alcoolisme quotidien dans son film, Louis Malle dans le Feu Follet met en scène un Maurice Ronet au sommet de l’élégance cuitarde.
On passe du shot au magnum, avec la cuite mono-dread de luxe et sa version hawaïenne et tong qui gratouille, Endless Summer,ivresse zgeg à l’air, des blondinets de surfeurs à la con qui s’en foutent plein la tronche sur les plus belles plages du monde : paradisiaque.
Etre digne dans la cuite, ça, c’était avant, quand le costume était sur-mesure et la raie bien à droite. Karamazov joué par Alain Chabat dans la Cité de la Peur, apothéose du binch-drinking, belle cuite provinciale dessinée au Macumba entre Vodka-Red Bull et Whisky-Coca, la pisse sur la banquette, l’effondrement au bar et le slogan du partouzeur solitaire, « toutes des putes ». Un coup de maitre. Titubant, la fiole rempli de diluants (une sorte d’alcool à 90° à te faire brûler une plaie croutée) dans The Master de P.T.Anderson, Joaquin Phoenix s’effondre dans le yacht du roi des scientologues, une rencontre rêvée par nos âmes en peine. On passe sous silence Projet X, Very Bad Tripet toutes les bouses récentes qui ne respectent plus rien, bande de petits cons.
La cuite oui, mais qui en serait le plus beau signataire ? Pas facile de tirer un alcoolique parmi les alcooliques, mais Clarke Gable fait définitivement office de maitre-fou. Connu pour être le roi de la bibine à Hollywood, il passa le tournage de Mogambo ivre mort du matin au soir, et pour contourner son interdiction d’alcool sur le tournage d’Autant en emporte le vent, Gable injectait des seringues remplis de gnole directement dans des oranges qu’il avalaient toute la journée. Un génie qui a souvent l’œil qui vrille, même dans le romantisme le plus pathos. Un autre génie imbibé jusqu’à la moelle, Barfly de Barbet Schroeder reprend la vie disaoûlu de Bukowski porté par le pas moins soulard Mickey Rourke. Ce pseudo biopic nous balance en pleine poire (« un petit digo ? ») la cuite qui terrifie, celle qui nous fait basculer du fun au glauque.
La solution par le verre, le coude qui flanche, les problèmes dissipés le temps d’une bouteille. Roi des cernes qui tombent, Bill Murray de Rushmore à Lost in Translationen passant par Broken Flowers, a toujours su parfaitement jouer la solitude profonde mais toujours avec l’haleine ambrée. Et ce, pour trouver un second souffle éthylique à sa carrière grâce notamment à Wes Anderson. Dans le registre « l’alcool me fait oublier mes problèmes », on peut citer Un singe en hiver de Henri Verneuil, réunion AA entre Gabin et Belmondo, la rêvasserie au champagne d’un Dumbo (1941) en pleure, l’alcoolisme ordinaire de campagne avec les 6 litres de pinard quotidien du Glaude et du Bombé dans le très profond La Soupe aux Choux ou le bien plus glauque Calvaire de pauvre Marc Stevens, séquestré et violé dans un village reculé des Ardennes belges. L’alcool, ami idéal d’un ennui littéralement mortel.
Les histoires d’alcool finissent mal. C’est arrivé près de chez vous, du Petit Gregory au comptoir jusqu’au viol collectif dans une cuisine de HLM, la ligne est franchie, les descentes aux enfers arrivent. Wake in Fright dessine une Australie profondément cuitarde, brutale et terrifiante, rarement un film n’a donné autant envi de s’exploser la gueule à coup de litrons de bière et s’inscrire en désintox, le tout dans la même seconde. On ne peut passer à côté de l’enterrement de vie de garçon de Very Bad Thing, celle qui a engendré les tragiques Very Bad Trip, entre une pute coincée sous les roues et un bain de sang ininterrompu. Mais aussi Black Out de Abel Ferrarra et son amnésie complète après une nuit d’ivresse glauquissime ou encore Le Poison de Billy Wilder et son week-end cauchemardesque se finissant en bon vieux delirium tremens, la salive qui dégouline, seul, la face au sol.
Quelle soit là pour nous faire rêver ou déprimer, nous promettre d’arrêter pour mieux recommencer, la cuite au cinéma n’est finalement que le destin tragique de nos vies contemporaines perdues, cherchant des réponses là où elle ne sont pas, au fond d’un cul de bouteille miteux. Et pourtant, le cinéma est là pour nous le rappeler, l’alcool est un parfait équilibre entre violence et réjouissance, beauté liquidienne soluble que l’on ait pas près d’arrêter de contempler.