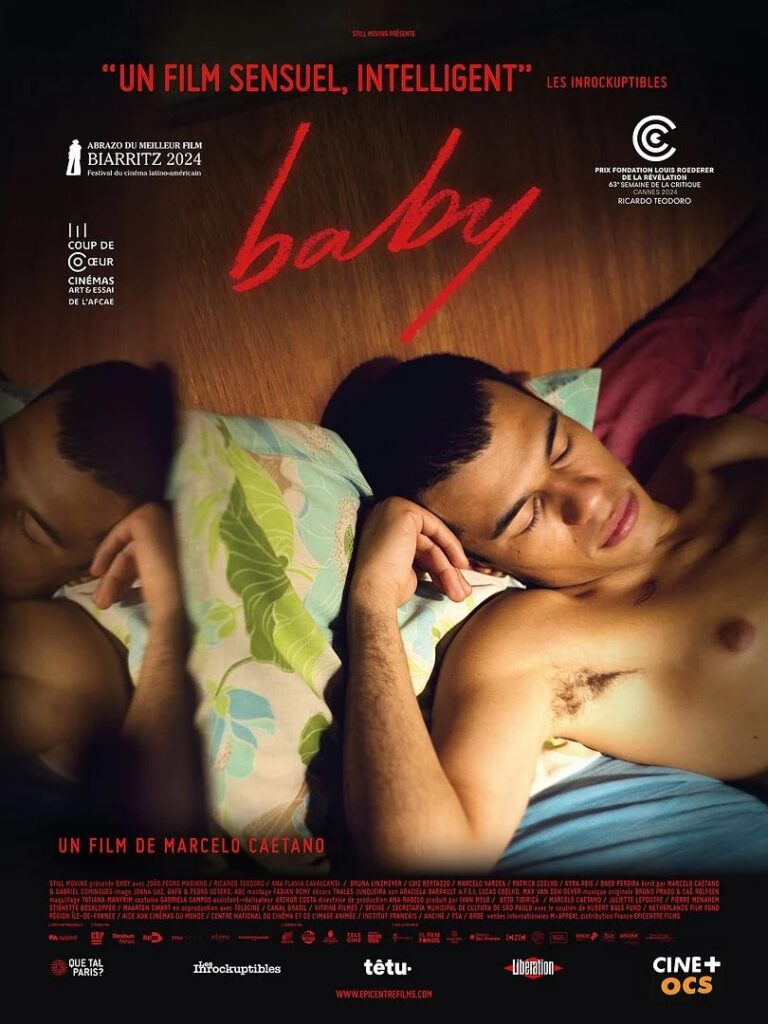La critique est à retrouver sur le site internet de Culturopoing.
Prix de la mise en scène au Certain Regard cannois l’année passée, « La mère de tous les mensonges » fait surgir de l’intime (une lourde histoire familiale) l’horreur historique des « années de plomb » marocaine, et le massacre de civils à Casablanca en 1981 par son gouvernement militaire en répression à la gronde grandissante d’un peuple à l’agonie en grève contre la flambée des prix des matières premières. Et c’est bien là le cœur battant du documentaire, l’imbrication décisive des silences, des non-dits, de ce ver qui gangrène et putréfie de l’intérieur, le secret de famille, et le choix délibéré de se taire. Face au non-dit de famille, le mensonge étatique marocain pour couvrir ces presque 600 morts (en majorité des enfants), la destruction automatique des preuves et l’entassement des corps dans une fosse commune cachée sous un terrain de football. Nous voilà plongés dans une guerre du silence, le geste de la grand-mère qui trace son doigt sur sa bouche en signe ostentatoire, elle qui ne cesse de rabâcher que « les murs ont des oreilles », et qu’il faut donc oblitérer le passé par peur qu’il ne ressurgisse et que la vérité ne peut qu’enrailler la paix familiale. Mais en réunissant une partie de sa famille, Asmae El Moudir va la faire ressurgir, certes avec douleur, fracas, et mise en péril d’un brinquebalant équilibre qui unissait tant bien que mal une famille terrorisée par la peur, mais avec un courage exemplaire : il est l’heure que les langues se délient, que la vipère (la « monstrueuse » grand-mère) soit prise au gosier, et fasse face à la réalité et la mise à nu du destin tragique d’une de ses filles.
On pense immédiatement à Rithy Panh (avec « L’image manquante ») et sa reconstitution du génocide cambodgien à l’aide de figurines illustratrices, El Moudir utilise le même procédé à la différence près que l’on suit ici son processus créatif, du modelage des pièces à la peinture au pinceau, de la fixation des cheveux à leurs habillages, mais aussi la construction minutieuse des décors miniatures qui représenteront le quartier de Casablanca où cette famille s’est construite puis déconstruite. L’édification du décor est aussi importante que son utilisation. Le façonnage se fait en famille, son père, sa mère, son oncle, tout le monde participe à sa constitution. Sauf la bête qui rôde, la grand-mère, impassible sur sa chaise en osier, observant, écoutant, jugeant. Elle retrouve bien naturellement son rôle de gardienne des temps passés, toujours là à épier, surveiller, son regard n’évitant pas un mouvement, ses oreilles à l’affût du moindre propos déplacé faisant ainsi régner un climat de terreur dictatoriale. Il y a une très belle scène où un portraitiste vient la dessiner, mais refusant la réalité de son visage daté, elle brise le miroir sur lequel l’artiste l’a croquée, drôle et brutale métaphore du refus de voir, y compris de sa propre image. En juin 1981, lorsque les mitraillettes ont commencé à résonner, les cris et pleurs réverbérés aux fenêtres, elle tira le rideau, enferma sa famille à double tour pour cacher, toujours cacher, mentir par omission, mais par-dessus tout, ne jamais en parler. L’on apprend également la disparition de toutes les photos de famille, brûlées par elle dans les flammes de l’oubli, à l’exception du portrait de Hassan II (roi marocain de l’époque) qu’elle a toujours fait trôner sur le mur du salon ; et cette photo sera d’ailleurs le seul souvenir qu’elle gardera en conclusion du film. Certes El Moudir nous offre une piste explicative à cette « monstruosité » aveugle par le tragique passé de sa grand-mère (mariée à 12 ans, violée, ayant perdu des enfants en bas-âges) mais elle montre avec intelligence une fascisation de l’esprit, une fascination difficilement intelligible pour un souverain symbole d’oppression. Cela rappelle directement une fascination similaire et malsaine au Chili, où Pinochet est encore par beaucoup considéré comme héros national, malgré les massacres perpétrés.
Le point d’orgue du film nait dans son dernier-tiers, un travail quasi psychanalytique de restitution lorsqu’un oncle recrée à partir de figurines et d’une maquette miniature de prison un autre massacre, le lendemain de la tuerie de Casablanca. La police entassera une cinquantaine d’hommes dans une cellule d’à peine 12 mètres carrés. La forme cinématographique prend alors une tournure théâtrale, cet oncle mimant les hurlements, l’asphyxie et les corps tombants, sa fuite en rampant, cette déshumanisation de « 36 cadavres traités comme des moutons égorgés » d’une mise en scène expiatoire d’un souvenir bien trop lourd à porter. Puis cette révélation finale qui tombe, cette gamine d’à peine 12 ans, cette tante pour El Moudir, cette fille pour sa grand-mère, cette sœur pour ses oncles et tantes, assassinée dans la rue, ensevelie dans une fosse commune, cachée par un terrain de football sur lequel son frère se rêvait joueur professionnel. Face à l’ignominie, la mine blafarde et absente de la grand-mère finit par céder (« c’est la première fois que je vois mamie pleurer ») d’un dernier plan fixe sur son visage enfin humanisé. Puis c’est la mise sous vide, le plastique recouvrant désormais maquettes et figurines en point final de cette rude épreuve de reconstitution.
La mixité de ses formes rend forcément le travail de mémoire plus ludique, mais réussit l’étonnant pari d’éviter l’écueil de la dramatisation à outrance, les visages s’expriment sans long discours, les regards se croisent et se parlent sans mots, les figurines prennent la place des corps, ce combat familial pour la vérité prend la forme d’une révolte engagée pour la vérité afin de s’opposer au diktat du silence et du mensonge et rompre définitivement avec la génération passé, sans jamais la renier.