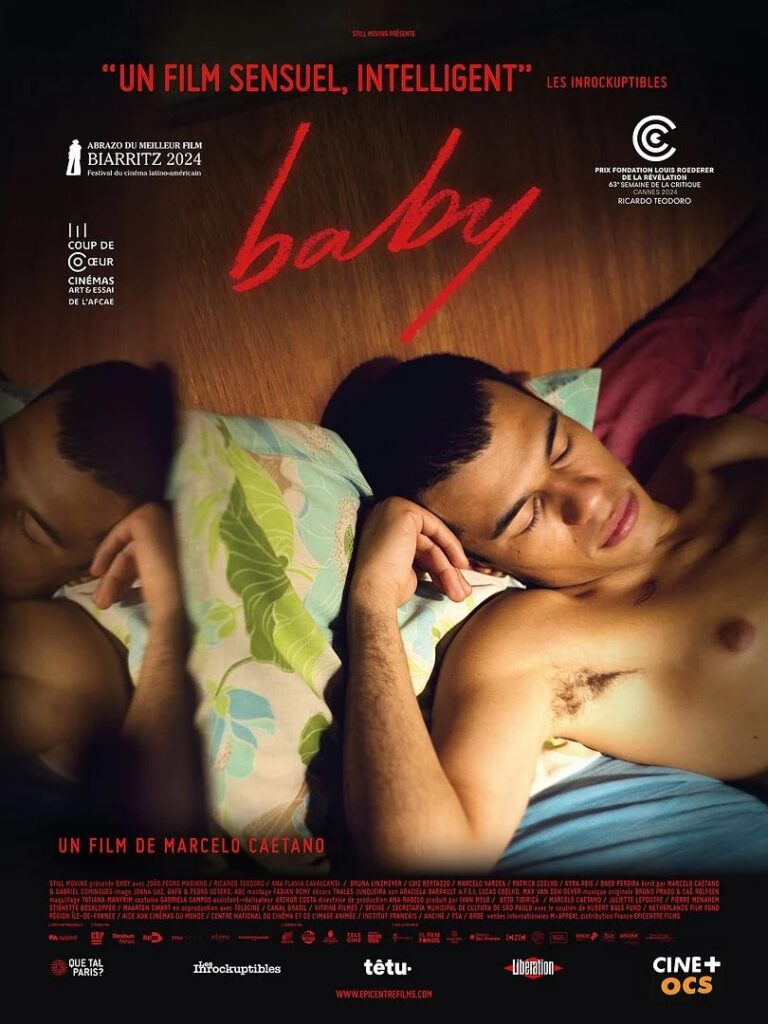Le split-screen de Vortex de Gaspard Noé intrigue, et de nombres hypothèses sont avancées pour l’expliquer. La mienne est la séparation dans la trajectoire vers la mort, celle entrainée par le défection du cœur avec Dario Argento, l’autre par celui du cerveau par Francoise Lebrun. Explications. Cet article est à retrouver dans le prochain numéro des « Cahiers du Cinéma » de mai 2022 rubrique « courriers des lecteurs ».

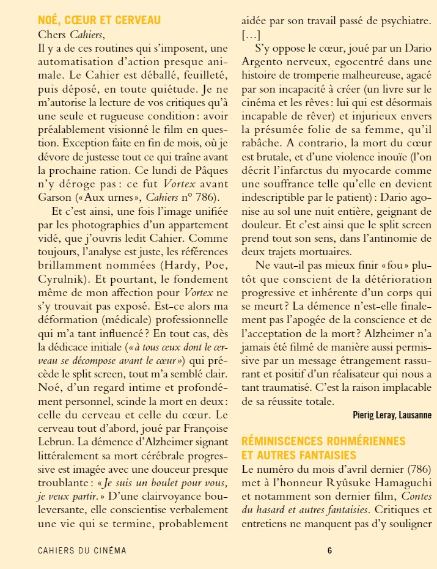
Dès la dédicace initiale (« à tous ceux dont le cerveau se décompose avant le cœur ») qui précède la séparation de l’écran, tout m’a semblé clair, Noé, d’un regard intime et profondément personnelle, scinde la mort en deux : celle du cerveau et celle du cœur. Le cerveau tout d’abord, joué par Françoise Lebrun, la démence d’Alzheimer signant littéralement sa mort cérébrale progressive est imagée avec une douceur presque troublante : Françoise est apaisée, elle qui devrait être inconsciente ne l’a pourtant jamais autant été : « Je suis un boulet pour vous, je veux partir ». D’une clairvoyance bouleversante, elle conscientise verbalement une vie qui se termine, probablement aidée par son travail passé de psychiatre. Et quoi de plus imagé que le suicide pour signer l’acception finale de la mort. Une mort « passive » rendue par le monoxyde de carbone, asphyxie indolore qui offre jusqu’à sa découverte à la morgue, un visage reposé. S’y oppose le cœur, joué par un Dario Argento nerveux, ego-centré dans une histoire de tromperie malheureuse et pathétique, agacé par son incapacité de créer (un livre sur le cinéma et les rêves : lui qui en est désormais incapable) et injurieux envers la présumé folie de sa femme qu’il ne cesse de rabâcher. A contrario, la mort du cœur est brutale, et d’une violence inouïe (l’on décrit l’infarctus du myocarde comme une souffrance telle qu’elle en devient indescriptible par le patient) : Dario reste agonisant au sol, une nuit entière à geindre de douleur. Là encore, chez Françoise où le cœur domine son intellect défaillant, elle agit avec calme et sérénité en appelant immédiatement son fils, et caressant le dos souffrant de son mari. En opposition, son visage défunt est quant à lui endolori, meurtri par la violence de son arrêt cardiaque. Et c’est ainsi que le split-screen prend donc ici tout son sens, dans l’antinomie de deux trajets mortuaires.
Ne mieux vaut il pas finir « fou » plutôt que conscient de la détérioration progressive et inhérente d’un corps qui se meurt ? La démence n’est elle finalement pas l’apogée de la conscience et de l’acceptation de la mort ? Alzheimer n’a jamais été filmé de manière aussi permissive par un message étrangement rassurant et positif d’un réalisateur qui nous a toujours tant traumatisé. Et c’est ainsi, la raison implacable de sa réussite totale.