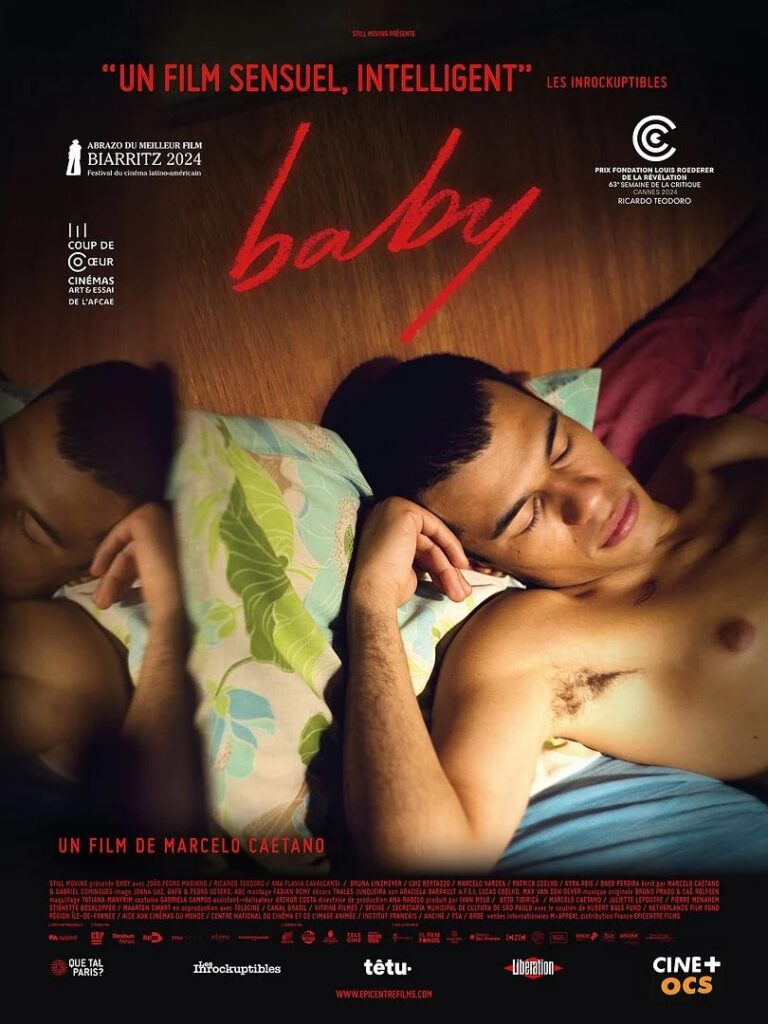La critique est à retrouver sur le site internet de Culturopoing.
Il y a chez Hong Sang-Soo une fausse apparence de redondance, de son cinéma prolifique, l’on pourrait bêtement lui reprocher de tourner en rond, répéter les beuveries au soju, et rester inerte dans un auto-conformisme ultra réglé. Mais ce serait faire une tragique erreur, car dépassé le jeu bêta des sept différences, il est indiscutable que le cœur de ses films ne cesse d’évoluer, ce grand théseux au regard d’agneau n’aspirant finalement qu’à une seule chose, sonder sous toutes ses formes notre humanité et ses affres. Depuis le superbe « Introduction » en 2021, Hong Sang-Soo pénètre désormais la voie de l’introspection en se mettant en scène à travers le personnage régulier du « cinéaste » (joué par Hae-Hyo Kwon). Il y a désormais une porosité troublante entre privé et fiction, une vidéo amateur de son téléphone pénètre même « La romancière, le film et le heureux hasard » (2023) avec ce merveilleux « je t’aime » face caméra de Kim Min-Hee, sa compagne dans la vie. Dans « Walk Up », HSS va encore plus loin, laissant s’insinuer la tortuosité de son âme à travers une lecture magistrale de la dépression, cette fantomatique maladie invisible et inaudible. De son cadre architectural inversé (un immeuble à Gangnam à Séoul, nous reviendrons plus tard sur son importance), l’on suit Byungsoo, cinéaste à la réputation dorée qui fera rapidement face à un échec déterminant entrainant sa lente et progressive déchéance. Là où HSS reste un cinéaste unique et majeur, c’est qu’il réussit une fois de plus à parler d’un sujet si vaste avec si peu (quelques détails suggestifs, une voiture qui disparaît, des corps qui se distancent, une idéologie qui s’inverse).
Byungsoo débarque chez Mme Kim, élégante femme au charisme naturel (Hye-Young Lee), mais qui ne cesse étrangement d’appuyer sur sa glorieuse réputation de cinéaste, l’admiration en devient malsaine et interrogatrice. Hautaine de nature, elle se targue bien maladroitement d’être une propriétaire ouverte (« on ne ferme jamais les portes ici ») , alors qu’elle cloisonne l’ensemble des parties communes de codes secrets. Les bruits des touches et d’ouverture des portes automatisées ne cesseront d’ailleurs de résonner tout le long du film. Tout est ici compartimenté, segmenté, hiérarchisé. Cette première impression n’est pas détrompée par l’avis de Jules, son employé qui l’a décrite comme une « femme gentille mais sélective », appâtée par « ceux qui ont du succès ou ceux qui ne la contredisent pas ». Byungsoo arrive au bras de sa fille, cette rencontre arrangée est organisée pour qu’elle puisse décrocher un stage auprès de Mme Kim. Byungsoo doit s’absenter, il doit rejoindre des producteurs pour discuter de l’avenir de son futur long-métrage. Cette absence enclenche la dramaturgie narrative du film, un grand angle s’ouvre sur le salon, se fait face Mme Kim et sa fille, les bouteilles de vin se vident et libèrent la parole, le sujet principal glissant désormais sur la personnalité de Buyngsoo. « Un renard rusé, calculateur » le décrit sa fille, un homme à deux visages, « bien différent entre l’extérieur et l’intérieur », jusqu’à cette questionnante description de « personne disparue ». Il y a ici une première pierre à une forme d’auto-psychanalyse qui voit HSS s’interroger sur la complexité de sa personnalité, cette guerre viscérale, ce combat de chaque instant entre la façade populaire et l’absence intérieure, cette mélancolie naviguant dans son «je », lui qui utilise le cinéma en exutoire boulimique de son mal être (son 29ième long métrage), comme un écrivain couche les mots pour verbaliser ses peines.
Une première ellipse temporelle voit arriver Byungsoo devant l’immeuble de Mme Kim, il est à pieds, sa belle voiture de collection a disparu et son visage semble marqué. Un déjeuner s’organise dans le restaurant du premier étage, mais cette fois-ci, au côté de Mme Kim, c’est la cuisinière qui a pris la place de sa fille. Le ton a changé, et c’est désormais la voix de HSS que l’on entend rugir à travers Byugnsoo: il jalouse la facilité créative du peintre (une simple observation du paysage et une toile blanche), se plaint frontalement de l’industrie cinématographique (« Il faut tellement d’argent pour faire un film »), attaque cette machination pécuniaire dirigée par des « producteurs qui ne pensent qu’aux bénéfices ». Ce terrible constat fait face à une révélation, un échec décisif, il annonce dans un silence de plomb que son prochain film ne sera pas produit, « un an de préparation pour rien », les larmes semblent retenues, la pudeur évite l’esclandre tragique et l’alcool en solution court-termiste vient couper court à la détresse.
Une nouvelle ellipse, et avec elle, la dégradation physique de Byungsoo : chemise à carreaux ouverte et débraillée, mine apathique, les mains dans la vaisselle. Il est désormais en couple avec la restauratrice et habite le second étage de l’immeuble de Mme Kim. Les verres de vin n’ont plus de pieds, sa carrière de cinéaste est abordée au passé (une rétrospective est organisée pour un festival à l’étranger), la gangrène est avancée, la solitude pèse sur son faciès. Quand Mme Kim surgit du cadre, les corps se distancent, le regard a changé, il n’y a plus de respect ni de considération. Une « maladie » rôde, elle est abordée pour la première fois par Byugnsoo qui semble désabusé par l’absence de diagnostic. L’eau s’infiltre dans le studio, des casseroles jonchent le sol, la douche est inutilisable à cause d’une odeur pestilentielle. Byungsoo s’allonge alors sur son lit mortuaire, terrassé par la fatigue, abattu, dévitalisé. Il s’imagine alors la discussion qu’il aura auprès de sa compagne, il veut la quitter (« Je dois vivre seul »). Il y ici cet appel irrésistible à la solitude, cette volonté d’isolement dirigée par la honte de l’absence. Le film se conclut d’une dernière ellipse terrassante : lui qui méprisait le religion en début de film (une « invention pour contrer la peur des hommes ») la porte désormais en plus haute estime. Il a vu Dieu, il l’a vu ici, sur sa terrasse (nous voilà au dernier étage de l’immeuble), un délirium, un illumination atonique qui va lui dicter de rejoindre sa fille oubliée. Lui qui était devenu végétarien par conviction se goinfre désormais de viande, lui qui partageait sa vie avec une artiste brillante est désormais au côté d’une femme d’une banalité confondante, le soju a remplacé les grandes cuvées, son studio est désormais insalubre : nous voilà dans la descente terminale, perdue dans les limbes de la dépression.
Le génie de « Walk Up », c’est cette inversion spectaculaire entre la chute (la dépression) et l’ascension, plus il s’enfonce psychologiquement, plus il s’élève physiquement. Au départ au rez-de-chaussée en grand cinéaste, puis au restaurant du premier étage lors de l’annonce de l’annulation de son prochain film, la maladie qui s’installe dans l’appartement du second étage, jusqu’à cette terrasse en point final. Mais que veux nous dire HSS avec cette inversion corps/âme ? La dépression est-elle finalement l’acte ultime d’une forme de désappropriation corporelle ? Une élévation divine comme suggère Byungsoo avec cette apparition miraculeuse ? Doit-on donc toucher le fond de l’aberration pour retrouver le chemin vers l’amour ? L’obscurité même la plus profonde s’accompagne toujours de l’espoir d’une éclaircie, le tunnel aura toujours une voie de sortie. Ici, même enfoui, l’amour pour sa fille semble jaillir du plus profond du désespoir. Hong Sang-Soo filme cette bête qui rôde (la dépression) avec une telle intelligence (cette inversion architecturale entre l’état dépressif de Byungsoo et sa montée progressive dans les étages de l’immeuble est du génie) prouvant une fois de plus la vitalité sans pareille de son imaginaire métaphysique. Nous voilà ainsi couplés à son destin, dans l’intimité de son âme, agglutinés à sa destinée, pour tenter, à notre tour, et à la lumière de son chemin, de trouver des réponses à nos propres interrogations intérieures, avec une passion décisive.